-
Par Marc81 le 8 Août 2018 à 10:27
À l'origine (XIe siècle) était le verbe faillir (d'abord falir ou fallir), emprunté du latin populaire fallire, lui-même issu du latin classique fallere (« tromper, échapper à, manquer à [sa parole] »). Sa conjugaison hésitait entre les formes en fal- et celles en faill- : (indicatif présent) il falt (puis fault, faut) ; (passé simple) il fali (ou failli, faillit) ; (futur) il faldra (puis faudra ou faillira) ; etc. Falloir, quant à lui, n'est autre que la réfection de faillir (pris au sens de « faire défaut, manquer ») sur le modèle de valoir (d'après il faut/il vaut, il faudra/il vaudra) : « Conjugué de façon impersonnelle, il me faut ce livre signifiait donc "il me manque ce livre", écrit Georges Gougenheim dans Les Mots français (1962) ; puis le sens est devenu "ce livre m'est nécessaire, j'ai besoin de ce livre". Cette conjugaison impersonnelle de faillir a donné naissance à un verbe indépendant qui a subi l'influence de valoir. À côté de il faut, il faudra... [formes reprises à faillir], on a créé un imparfait il fallait, un passé simple il fallut et un infinitif falloir. » Falloir s'est ainsi complètement détaché de son doublet faillir (entre le XVe et le XVIe siècle ?). Le sens originel « manquer de » s'est toutefois conservé dans le pronominal s'en falloir, qui s'est substitué à s'en faillir.
Précédé du pronom impersonnel il (sujet apparent ou grammatical), s'en falloir se construisait jadis avec un sujet réel (ou logique) : « Il ne s'en fault que demie aulne / Pour faire les six justement » (La Farce de Maître Pathelin, vers 1460), « Il ne s'en est rien fallu qu'il n'ait esté tué. Il s'en fault deux pieces de monnoye » (Robert Estienne, 1539), comprenez : il manque la longueur d'une demi-aune, très peu de chose, deux pièces de monnaie (pour que...). Dans le cas où le sujet réel était non plus un nom mais un adverbe employé comme pronom indéfini (1), deux constructions (syntaxiquement différentes mais sémantiquement équivalentes) étaient possibles, selon que ledit pronom indéfini était placé après ou − l'impersonnel il étant souvent omis en vieux français − avant le verbe : il s'en faut peu (petit, beaucoup, guère, tant...) (que) et peu (petit, beaucoup, guère, tant...) s'en faut (que), comprenez : il manque peu, beaucoup (pour que), d'où : on est près, loin du résultat escompté. Témoin ces exemples anciens : (XIIe siècle) « Petit s'en falt [2] que [...] », « Mais molt petit en falt » (Le Roman d'Énéas) ; « Je ne sui pas / Del tot morte, mes po an [ou s'en] faut », « Molt po de chose s'an failloit que [...] » (Chrétien de Troyes) ; (XIIIe siècle) « Petit s'en fali qu'il ne l'ochist » (Le Roman de Tristan en prose) ; « Peu s'en fali », « Il s'en a mout peu falu que [...] » (Le Roman du Hem) ; « Il sont, ne s'en faut gaires, tout corrompu » (Philippe de Beaumanoir) ; (XIVe siècle) « Sachez que petit s'en fault » (Gace de La Bigne) ; « Il en falut petit que de son sens n'issy » (La Vie de saint Eustache) ; (XVe siècle) « Ainsi les trouverent tous, ou peu s'en failloit, desarmez » (Philippe de Commynes) ; « Cinq ans apres ou gueres ne sen fault » (Nicolas Mauroy) ; (XVIe siècle) « Tu es des tiens peu s'en fault adoré » (Clément Marot) ; « Peu s'en faillit qu'il ne le defonçast », « Tant s'en faut que je reste cessateur et inutile » (Rabelais) ; « Peu s'en a fallu que je n'ay dit ce qu'il fault taire » (Jean Pillot) ; « Beaucoup s'en faut qu'ils en ayent tant que nous » (Henri Estienne) ; « Il s'en fault tant que je sois arrivé à ce [...] degré d'excellence [que...] » (Montaigne). (3)
Seulement voilà, observe Goosse : ces formules, cessant peu à peu d'être comprises, subirent des altérations. D'une part, le sujet réel placé après le verbe y a été perçu comme un complément de mesure (4) − évaluant ce qui fait défaut pour que le procès de la proposition complétive (exprimée ou sous-entendue) se réalise −, que l'on a construit avec la préposition de (5) : « Il s'en fault de beaucoup » (Jean Calvin, vers 1558), « Il ne s'en fallut de gueres qu'il ne l'espousast » (Claude de Trellon, 1594), « Il s'en fallut de peu qu'on ne combatit » (Thomas de Fougasses, 1608), « Il ne s'en fallut que d'un moment » (Voltaire, 1768), « Est-ce à dire [que] j’adhère à tous vos jugements ? Il s’en faut de quelque chose, Monsieur » (Joseph d'Haussonville, 1872), « Il ne s'en fallait pas de grand-chose » (Raymond Roussel, 1897), « Il s'en fallait toujours d'un fil ! » (Céline, 1936), « Il s'en faut de cinq ans qu'elle ait roulé dans le panier » (Sartre, 1963). D'autre part, de « purs » adverbes vinrent concurrencer peu, beaucoup, tant... qui, dans ces emplois, étaient de moins en moins sentis comme des pronoms indéfinis : que l'on songe à bien s'en faut, tenu pour un gasconisme, et, plus récemment, loin s'en faut, né du croisement fâcheux entre tant (ou bien) s'en faut et loin de là.
Des grammairiens, à la suite de Vaugelas, voulurent établir une distinction entre la tournure avec de, qu'ils réservaient à l'expression d'une différence de quantité, et celle sans de, qui indiquait une différence de qualité (6) ; mais beaucoup s'en fallut que cette règle fût toujours respectée (ne serait-ce que par les académiciens eux-mêmes). De nos jours, observe Girodet, la construction avec de tend à s'imposer dans tous les cas (7), mais « cette généralisation abusive n'est pas conseillée ». Notre spécialiste ne croit pas si bien dire : la tentation de recourir aux variantes de peu s'en faut, de beaucoup s'en faut, par analogie avec il s'en faut de peu, il s'en faut de beaucoup, n'en a été que plus grande. Sauf que ce qui était envisageable à droite du verbe s'en falloir n'aurait jamais dû l'être à gauche ; c'est du moins ce qu'affirment les Le Bidois père et fils dans leur Syntaxe du français moderne (1938) : « L'emploi de la préposition de est impossible devant peu [beaucoup, etc.] quand ce mot se trouve en tête de locution. » (8) Hanse et Goosse se veulent rassurants : n'affirment-ils pas dans une touchante unanimité que de tels exemples sont « exceptionnels » (selon le premier), « rares » (selon le second) ? C'est vite dit : « De peu s'en fault que le cœur plein de rage [...] / Ne crie en hault » (Béranger de La Tour, 1551) ; « Il se fust du tout abstenu de parler, de tant s'en faut qu'il eust ornée et polie sa parolle » (François Bonivard, 1563) ; « Je ne suis pas encore morte, mais de peu s'en faut ! » (Milli de Rousset, 1780) ; « De peu s'en est fallu que l'amateur vindicatif n'ait été renvoyé » (Julien Louis Geoffroy, 1805) ; « Cette limite n'est jamais assez forte pour arriver jusqu'à l'équilibre, de beaucoup s'en faut » (Henri Fonfrède, avant 1841) ; « [Tel organe de presse étrangère] a, de peu s'en faut, les dimensions du Journal des Débats » (Pierre Gustave Brunet, 1841) ; « Quand Balzac vint au monde, [...] la littérature française était morte ou de peu s’en faut » (Le Messager de l'Assemblée, 1851) ; « − Mais le canapé n'est pas achevé ? − Oh ! de bien peu s'en faut » (Ponson du Terrail, 1866) ; « De peu s'en fallut qu'il ne trouvât interminables les trente tours de roue qu'il y avait » (Élémir Bourges, 1884) ; « [Des] phénomènes devant se reproduire, ou de peu s'en faudrait, partout où le gouvernement démocratique s'établira » (Émile Faguet, 1894) ; « Un frère aussi pauvre qu'elle, ou de guère s'en faut » (Eugène Le Roy, 1901) ; « Mais il n'a pas tout dit, de bien s'en faut » (Frédéric Mistral, 1906) ; « Tel est bien le cas de la France actuelle, ou de trop peu s'en faut » (Justin Fèvre, 1906) ; « Un recueil de chants populaires [...] ne donne pas toujours, de tant s'en faut, l'émotion artistique recherchée » (Jean-Baptiste Galley, 1909) ; « Me voici parvenu à la quatre centième page du présent livre, ou de peu s'en faut » (Maurice Dreyfous, 1912) ; « L'insecte n'est pas mort, de bien s'en faut », « Il y fait, de peu s'en faut, aussi froid qu'au dehors », « De véritables œufs, pareils, de guère s'en faut, à ceux que [...] » (Jean-Henri Fabre, avant 1915) ; « Taine ne va pas tout à fait si loin, mais de peu s'en faut » (Henri Bremond, 1923) ; « Les réformes limitées qui viendraient à s'imposer d'elles-mêmes, ou de peu s'en faut » (Jacques Chirac, 1978) ; « Les mêmes observations valent, ou de peu s'en faut, pour [...] » (Gérald Antoine, 1981) ; « Ce n'est pas un drame, de beaucoup s'en faudrait, je l'admets » (Franz Bartelt, 2015) ; et il n'est que de parcourir la Toile pour y trouver matière à compléter cette liste, déjà longue.
Par réaction contre cette dérive ou, plus vraisemblablement, par excès de simplification, l'Académie (ainsi que la plupart des dictionnaires actuels) est venue ajouter à la confusion ambiante en donnant à croire, dans la neuvième édition de son Dictionnaire, que la préposition de est attachée au verbe plutôt qu'à son complément : « S'en falloir de, suivi généralement d'un nom ou d'un adverbe de quantité, se dit pour indiquer une différence en moins. » Il n'en est évidemment rien, tant s'en faut, car sinon, pourquoi les Immortels auraient-ils supprimé de la huitième édition (1932) l'exemple Il ne s'en faut de guère ? C'est parce que de guère − comme de tant, mais contrairement à de peu, de beaucoup − ne s'emploie plus... guère en français moderne (9) pour estimer une différence que l'on ne dit plus de nos jours Il ne s'en faut de guère ni Il s'en faut de tant, mais Il ne s'en faut guère et... Tant s'en faut ! Pour ne pas être pris en flagrant délit de contradiction (10), les académiciens ont donc préféré pratiquer la politique de l'autruche en supprimant purement et simplement tous les exemples devenus embarrassants (Il ne s'en est guère fallu se trouvait encore dans la huitième édition) plutôt que de préciser : « S'en falloir, suivi (généralement [11]) d'un syntagme nominal précédé de la préposition de, d'une locution adverbiale de quantité (de beaucoup, de peu, de rien) ou d'un adverbe (bien, guère...). »
Goosse n'est pas en reste quand il s'agit d'user de raccourcis. Ne qualifie-t-il pas les tours peu s'en faut, tant s'en faut (ainsi que beaucoup s'en faut et bien s'en faut, présentés comme « rares ») de « formules figées d'une syntaxe archaïque » ? Va pour la syntaxe archaïque (antéposition du pronom indéfini, omission du pronom impersonnel) et pour la lexicalisation (au sens de « presque » pour le premier, de « loin de là, bien au contraire » pour les suivants), mais avouez que l'on a connu degré de figement autrement élevé : (peu, très peu, bien peu, si peu, beaucoup, bien, tant, tant bien...) s'en faut (s'en fallait, s'en fallut, s'en est fallu...). C'est que les expressions construites avec s'en falloir doivent suivre le temps du verbe qu'elles régissent, si l'on en croit les exemples donnés dans la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie (12) : « Peu s'en fallut qu'il ne fût expulsé. Elle n'était plus, tant s'en fallait, de première jeunesse. Il s'en est fallu de quelques points qu'il fût reçu. La balle a failli l'atteindre, il s'en est fallu de l'épaisseur d'un cheveu. »
Et que penser encore des désaccords de nos spécialistes sur l'emploi de ne dit « explétif » après s'en falloir ? Littré et Thomas s'en tiennent à la règle traditionnelle (13) − que Girodet réserve à « l'usage soutenu », et l'Académie, à la langue « littéraire » −, selon laquelle ladite particule est requise dans la proposition subordonnée quand s'en falloir est en tournure négative, restrictive (modifié par un mot comme peu, guère, presque, rien, seulement...) ou interrogative : (avec ne) « Il ne s'en est pas fallu l'épaisseur d'une épingle qu'ils ne se sayant nayés [soient noyés] tous deux » (Molière), « Il ne s'en fallut pas de beaucoup que la chaleureuse déclaration de Tiburce ne fût noyée sous un moral déluge d'eau froide » (Gautier), « Il ne s’en est cependant quasi rien fallu que je ne l'aie percé de mille coups » (Savignien de Cyrano de Bergerac), « Il ne s'en fallait rien que la fortune ne me mît dans la plus agréable situation du monde » (Mme de Sévigné), « Il ne s'en fallait guère qu'un accident ne mît un terme à tous mes projets » (Chateaubriand), « Il s'en est fallu de peu qu'ils n'y fussent pas » (Mauriac), « Peu s'en faut que d'amour la pauvrette ne meure » (Molière), « Combien s'en faut-il que notre santé ne soit entièrement désespérée ? » (Bossuet) ; (sans ne, en tournure affirmative) « Tant s'en faut que l'ardeur de mon feu diminue » (Ronsard), « Il s'en fallait donc de sept à huit cents piastres pour qu'[ils] pussent réunir la somme demandée » (Dumas père), « Il s'en faut de beaucoup qu'il soit laid » (Sand), « Il s'en faut bien qu'elle soit sans agréments » (Stendhal). Pour les Le Bidois, il n'y a pas ici à donner de règle absolue : « C'est avant tout affaire de pensée (et d'oreille aussi, quelquefois). Quand il y a lieu de souligner la valeur négative, (ou encore si la présentation de la phrase paraît requérir plus de fermeté et de plénitude), la présence de ne dans la subordonnée peut, à la rigueur, se justifier [...]. Autrement, il semble bien que la justesse n'a qu'à perdre à l'intrusion de ne. » Même son de cloche, ou peu s'en faut, du côté du Robert : « Dans ces propositions, l'emploi de ne est fonction du jugement du locuteur sur l'estimation de la différence. On dira : Il s'en faut seulement de quelques millions que le budget de l'État ne soit en équilibre, mais quand la différence en moins est considérable : Il s'en faut de cent milliards que le budget soit en équilibre. » Hanse, pour sa part, avoue ne percevoir aucune nuance de sens : « Il s'en est fallu de peu qu'il vînt ou qu'il ne vînt (= il a failli venir) », avant d'ajouter : « S'il y a négation du verbe subordonné, on doit employer ne pas : Il s'en est fallu de peu qu'il ne vînt pas (= il a failli ne pas venir). »
Vous l'aurez compris : la syntaxe du verbe pronominal impersonnel s'en falloir n'a rien d'une sinécure, tant il y est difficile de démêler le vrai du... faut !
(1) Comme dans : Il a fait beaucoup pour moi. Peu le savent. Il est à noter que les adverbes de degré ne peuvent pas tous être employés avec la valeur pronominale : « Ces emplois sont exclus pour bien », précise Goosse.
(2) Ou, selon les sources, en falt. L'ancienne langue semble avoir hésité entre en falloir et s'en falloir... voire falloir seul : « Peu faut que je ne vous estranle » (Adam de la Halle, XIIIe siècle), « Petit fault que chescune la chambre ne veudait » (Lion de Bourges, XIVe siècle), « Ne failloit gueres que chacun coup qu'il toussoit qu'il ne fust oy de la chambre » (Les Cent nouvelles nouvelles, vers 1460).
(3) On voit bien que, dans ces emplois, les formes conjuguées viennent historiquement de faillir. D'où la remarque de Vaugelas, qui considérait « peu s’en est fallu », en lieu et place de « peu s’en est failli », comme une « confusion » de l’usage (sans doute abusé par les formes communes aux deux conjugaisons). Aussi ne s'étonnera-t-on pas de trouver encore au XVIIIe siècle : « L'échapper belle, c'est-à-dire s'en faillir peu que l'on ne périsse » (Dictionnaire français et latin de Joseph Joubert, 1710).
(4) Littré, de son côté, parle de complément adverbial : « Cette construction [il s'en est fallu l'épaisseur d'un cheveu] s'explique ainsi : il, sujet indéterminé, c'est-à-dire l'épaisseur d'un cheveu [sujet réel], s'en est fallu [= a manqué]. On dirait aussi : il s'en est fallu de l'épaisseur d'un cheveu ; mais alors l'explication grammaticale est différente : il s'en faut se dit absolument pour signifier il y a une différence en moins ; et de l'épaisseur d'un cheveu devient une locution adverbiale qui modifie il s'en faut. » Avec la phrase Il s'en fallait beaucoup que la Russie fût aussi peuplée, cela donne : il (sujet apparent), c'est-à-dire beaucoup (sujet réel, mis pour « un grand nombre, une grande quantité ») s'en fallait (= manquait) (pour) que la Russie fût aussi peuplée ; avec la préposition de : il s'en fallait (= il y avait une différence en moins) de beaucoup (locution adverbiale servant à souligner l'importance de l'écart exprimé) (pour) que la Russie fût aussi peuplée.
(5) Par analogie avec la construction des compléments de mesure après un verbe énonçant la différence, le retard, la supériorité... : Il l'a emporté de beaucoup, de peu. Ils se sont manqués d'une minute. Elle le dépasse de dix centimètres.
(6) Pierre-Benjamin Lafaye ajoute, dans son Dictionnaire des synonymes (1858), que la présence de la préposition de dans ces expressions suppose une appréciation plus exacte de la différence, qui aura pu être mesurée avec quelque rigueur.
(7) Le tour sans de est présenté comme « très vieilli » dans la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie (Hanse se contente de la mention « vieilli »).
(8) L'emploi de de en tête de proposition, devant une expression désignant la mesure de différence, est pourtant attesté en ancien français : « De peu me sert que [...] » (Roman du châtelain de Coucy et de la dame du Fayel, fin du XIIIe siècle), « De tant elle [une verrière] est plus tost brisée » (Le Ménagier de Paris, XIVe siècle).
(9) De guère n'était pas rare dans l'ancienne langue : « Ilz ne se teurdroient de gaires » (Jean d'Arras, vers 1392), « Monsieur n'a menty de gueres » (François Béroalde de Verville, 1617), « L'âge ne sert de guère » (Molière, 1661). D'après Goosse, ledit tour est « encore usité à Lyon et en Provence » : « Il ne s'en est fallu de guère que je ne vienne pas t'appeler ! [dit un jeune Provençal] » (Marcel Pagnol, 1957).
(10) Ce fut notamment le cas du Petit Robert 1987 : « S'en falloir (il s'en faut) de. Avec un adverbe de quantité. Il s'en faut de beaucoup, Il s'en faut bien. » Comprenne qui pourra !
(11) Que se cache-t-il derrière cet adverbe ? L'emploi absolu Il s'en faut (= loin de là, bien au contraire) : « Hélène n'a pas l'oreille prude, il s'en faut » (Colette) ? La construction avec une proposition complétive (au subjonctif) comme sujet réel : « Il s'en fallait que leur goût fût excellent » (Romain Rolland) ? Mystère...
(12) On a ainsi reproché à Racine ce vers d'Athalie : Peu s'en faut que Mathan ne m'ait nommé son père. « Peu s'en est fallu » n'aurait-il pas mieux respecté la concordance des temps ? s'interroge le grammairien Pierre Fontanier dans ses Études de la langue française (1818).
(13) Établie par le grammairien Noël-François De Wailly dans ses Principes généraux et particuliers de la langue française (1754) ?
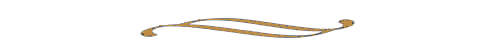
Remarque 1 : Le verbe impersonnel falloir n'est usité qu'à l'infinitif, au participe passé (toujours invariable et servant uniquement à former les temps composés) et à la troisième personne du singulier de tous les temps et modes.Remarque 2 : Sont également attestées en ancien français les expressions a poi, a petit, a peu... (que) au sens de « peu s'en faut (que) » : « A po qu'il ne l'anbrace » (Chrétien de Troyes), « A peu que le cuer ne me fent » (François Villon).
Remarque 3 : Voir également les billets Loin s'en faut et Il faut mieux.
.
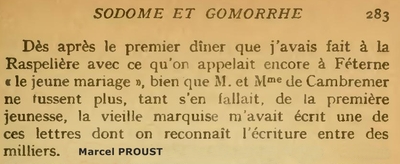
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 5 Mai 2018 à 15:33
Inutile de chercher dans le calendrier officiel de l'Église catholique : sainte nitouche n'y figure pas. C'est que l'intéressée fait partie, avec glinglin, frusquin et quelques autres, de ces figures fantaisistes et facétieuses que l'imagination populaire a forgées de toutes pièces. Enfin de toutes pièces, c'est vite dit. À y regarder de près, le cas qui nous occupe, pour ne parler que de lui, était en oie de formation depuis le XVe siècle : laquo; Ton maistre faisant l'ignorant et le non-y-touche » (Georges Chastelain, vers 1460), laquo; Maiz il caquecte par derriere / Et sy fait semblant qu'il n'y touche » (Pierre Michault, 1466), « Quant elle marche sur espinettes [petites épines] / Elle faict ung tas de minettes [mimiques ?]. / On dit cette femme n'y touche » (Guillaume Coquillart, avant 1510), « Vous faites la discrète, / Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette » (Molière, 1669). Vous l'aurez compris, nitouche n'est autre que la corruption plaisante de la locution (qui) n'y touche (pas), ainsi que le confirme une note dans l'édition de 1785 de La Pucelle d'Orléans de Voltaire : « On disait autrefois sainte n'y touche, et on disait bien ; on voit aisément que c'est une femme qui a l'air de n'y pas toucher. »
Mais qui a l'air de ne pas toucher à quoi ? « Essentiellement aux choses qui sont dans la braguette des messieurs », bref aux plaisirs de la chair, comme le prétend Claude Duneton dans La Puce à l'oreille (1978) ? Grand Dieu ! pas nécessairement ! Rappelons ici, avec le Dictionnaire du moyen français, qu'au XVe siècle faire le non-y-touche signifiait sans plus d'arrière-pensée « affecter un air d'innocence et de naïveté », et ne pas y toucher, « ne pas être concerné, se désintéresser de quelque chose, rester inactif » (avant de prendre le sens de « ne pas avoir de malice », selon Littré). Aussi ne s'étonnera-t-on pas de voir la définition de nitouche varier au cours des siècles : « An hypocrite ; an over-scrupulous Puritain » (Randle Cotgrave, 1611), « Une femme qui fait la discrette ou retenue » (Antoine Oudin, 1640), « Un hypocrite, ou un homme simple et innocent, qui ne paroît pas [être] capable de faire aucun mal » (1) (Furetière, 1690), « Une femme dissimulée, dont il semble qu'elle n'y touche pas, et qui cependant nuit aux gens de fait et de paroles dans les occasions, ou bien qui faisant la dégoûtée, semble ne vouloir toucher de rien de ce qui a été mis devant elle » (Jacob Le Duchat, avant 1735), « Une femme qui fait la prude, la dégoutée, comme si elle ne daignoit toucher aux mets qu'on lui sert ; et aussi une personne dissimulée et patelineuse, pour dire qu'elle pince sans rire, et que quand elle raille, il ne semble pas qu'elle y touche » (Gilles Ménage, 1750), « Une prude, une fille hypocrite qui, tout en se permettant beaucoup de plaisirs clandestins, a soin d'éloigner toutes les apparences, en sorte qu'on croirait à la voir qu'elle n'y touche pas, qu'elle ne touche à rien d'impur, qu'elle ne goûte aucun plaisir profane » (François Noël, 1831), « Une personne qui contrefait la sagesse ou la dévotion, qui affecte des airs d'innocence, de simplicité, de modestie » (Dictionnaire de l'Académie, depuis 1835), « Une personne qui fait semblant de ne pas vouloir d'une chose qu'elle brûle d'avoir ; qui affecte un air de douceur et de réserve que son cœur dément » (Pierre-Marie Quitard, 1842), « Personne hypocrite, doucereuse, affectant la simplicité et l'innocence » (Littré, 1877), « Une fille excessivement modeste » (Michael Andrew Screech, 1970), « Personne qui se donne une apparence de sagesse, qui affecte l'innocence, et, en particulier, femme qui affecte la pruderie » (Larousse en ligne, 2008), « Une personne qui affecte l'innocence, et spécialement une femme de mœurs faciles qui affecte la pruderie » (Dictionnaire historique de la langue française, 2012). La nature ambivalente du mot touche − présenté, selon les sources, comme « indicatif ou impératif du verbe toucher » (Gilles Ménage, 1750), « troisième personne au singulier du présent de l'indicatif du verbe toucher » (Benjamin Legoarant, 1832), « 2e personne du singulier du présent de l'impératif de toucher » (Grand Larousse de la langue française, 1978), « forme conjuguée de toucher » (neuvième édition du Dictionnaire d'une Académie bien évasive) − n'arrange rien à l'affaire : « On peut comprendre de deux façons [l'expression "ne pas y toucher"] : une interdiction à celui qui voudrait tenter sa chance ("bas les pattes !") ou un certificat de bonnes mœurs pour la demoiselle qui ne saurait "manger de ce pain-là" ("je ne suis pas celle que vous croyez !") » (Jean Maillet, 500 expressions populaires décortiquées, 2017). Alors sainte nitouche : patronne imaginaire de l'hypocrisie, de l'austérité des mœurs, de la modestie ou de l'innocence ?
Le sens, au demeurant, n'est pas le seul écueil que nous réserve notre expression. Que l'on songe aux innombrables variantes graphiques et syntaxiques attestées depuis le début du XVIe siècle : (au singulier) « Saincte Nytouche ! » (Rabelais, 1534), « Une vieille qui sembloit a veoir une sainte nytouche » (Antoine Le Maçon traduisant Boccace, 1545), « Te voyant si dévote et faire tant la sainte Nitouche » (Odet de Turnèbe, vers 1580), « Voyez un peu saincte Nitouche » (Jean-Antoine de Baïf, 1581), « Par saincte Nytouche ! » (Philippe de Marnix, 1601), « Faire de la saincte nitouche [également orthographié saincte-n'y-touche] » (2) (Randle Cotgrave, 1611), « Ces petits mignons / Qui font de la sainte Nitouche / Aussitôt que leur doigt vous touche » (Mathurin Régnier, avant 1613), « Il monstre à la Bourgeoise tout ce qu'il porte de plus secret. Pour faire la saincte Nitouche en s'escriant, elle couvre soudain ses yeux avec sa main, dont elle entr'ouvre neantmoins les doigts, finement hypocrite qu'elle est » (Charles Sorel, 1623), « D'un air d'une sainte Nitouche » (Paul Scarron, 1648), « Air sainte n'y touche, veut dire un air hypocrite » (Philibert-Joseph Le Roux, 1718), « Défiez-vous de cette Sainte Nitouche » (Dictionnaire de Richelet, édition de 1732), « Sainte Nitouche ou Mitouche, comme on prononce aujourd'hui » (3) (Gilles Ménage, 1750), « Les jeunes filles, en dansant, / Faisaient un peu la nitouche » (Henri-Joseph Dulaurens, 1766), « Bonne sainte Nitouche, le malheureux est damné ! » (Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, 1771), « Avec son petit air de sainte n'y-touche, la belle madame de la Baudraye est pleine d'ambition » (Balzac, 1831), « Voyez-vous la sainte n’y touche ! » (Pierre Tournemine, 1834), « Quand le docteur Minoret n'aura plus sa tête, cette petite sainte nitouche le jettera dans la dévotion » (Balzac, 1841), « Avec son air de sainte-nitouche, [...] on lui aurait donné le bon Dieu sans confession » (Eugène Sue, 1843), « Les prudes femmes, l’œil baissé sur la modestie, avec un air de Sainte N'y touche » (Théophile Gautier, 1863), « Avec son air de sainte n'y touche, elle est hardie, fière et entêtée » (Émile Gaboriau, 1866), « Quand on fait la sainte-nitouche [...] » (Huysmans, 1879), « Elle avait pris, en parlant, un petit air indifférent, sainte-nitouche » (Guy de Maupassant, 1882), « D’une douceur de sainte-n'y-touche à lui donner le bon Dieu sans confession » (Zola, 1890), « Fais la sainte-nitouche ! Tu n'étais pas si bégueule à l'École ! » (Colette, 1901), « Elle faisait la nitouche à présent » (Céline, 1944), « Ma fille est une sainte... la Nitouche de mes vieux jours » (René de Obaldia, 1963) ; (au pluriel) « Les Jesuites [...] sont de francs hipocrites, qui font les saintes Nitouches pour penetrer par tout et pour en attraper » (Guy Patin, 1653), « Moi qui sais le tarif, voir ces saintes-nitouches / S'offrir dans l'ombre en vente et faire les farouches, / Ça m'assomme » (Hugo, 1881), « On se serait cru dans une assemblée de Saintes-n'y-touchent et de Tartuffes » (Paul Lafargue, 1891), « Je ne joue pas les saintes-nitouche [...] Mais à toutes mes plaintes elles répondaient, les saintes-nitouches » (Octave Mirbeau, pris en flagrant délit d'hésitation, 1900), « Réservez vos reproches pour d’autres personnes qui jouent les sainte nitouche » (Henri Mongault traduisant Gogol, 1925), « Il ne se moque jamais des choses religieuses comme font certaines saintes nitouches » (Henry de Montherlant, 1951), « Jouer les sainte-Nitouche » (Jean Maillet, 2017). Majuscule, trait d'union, i grec, pluriel : le commun des mortels ne sait à quel saint se vouer ! Aussi l'Académie entreprit-elle (en vain, semble-t-il) de mettre un peu d'ordre dans cette farce : « C'est une sainte nitouche. Il fait la sainte nitouche. Prendre un air de sainte nitouche », lit-on dans les dernières éditions de son Dictionnaire, avec la minuscule à saint (dans la mesure où il n'est pas ici question d'un nom de fête, de rue, de lieu, etc. [4]) et à nitouche (dans la mesure où le mot, traité comme un nom commun, désigne non pas à une personne canonisée par l'Église, mais un personnage fictif), sans trait d'union (5) et avec un i normal (le grec n'étant plus en odeur de sainteté depuis belle lurette). Girodet confirme : « Sans trait d'union et sans majuscule : une sainte nitouche, des saintes nitouches. » Mais voilà que l'académicienne Danièle Sallenave se prend les pieds dans le saint tapis en écrivant sur le propre site Internet de la vénérable institution : « "sainte Touche" [patronne imaginaire du jour où l'on reçoit ou touche son salaire] s’est évidemment forgé sur le modèle d’une autre sainte de fantaisie, beaucoup plus ancienne, et repérée dès le XVIe siècle, "sainte Nitouche" ("sainte n’y touche"). » Décidément, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints !
(1) Selon François Noël (1831), « sainte-nitouche ne s'emploie qu'au féminin, et l'on ne dit pas un saint-nitouche en parlant d'un homme ». Même son de cloche dans Le Bon Usage : « On écrit : une sainte nitouche ("un ou une hypocrite"). » Force est de constater que tous les spécialistes ne l'entendent pas de cette oreille : « Il faut écrire saint-ny-touche. Un Hypocrite, un homme qui fait tellement du saint et du scrupuleux qu'il fait conscience de toucher, quand ce ne seroit que du bout du doigt, à rien qui soit souillé ou estimé profane » (Jacques Moisant de Brieux, 1672), « Comme c'est y toucher, employé négativement dans ce sens, qui a donné Nitouche, et que ce même verbe se dit indifféremment des deux sexes, je crois que si l'on emploie Nitouche précédé de sainte en parlant d'une femme, on doit logiquement employer ce mot précédé de saint lorsqu'on parle d'un homme » (Éman Martin, 1876). Ainsi trouve-t-on : « Et toi qui fais le sainte-nitouche, avec ton air sournois » (Eugène-François Vidocq, 1845), « Cette sainte nitouche de M. Tressilian » (Léon de Wailly traduisant Walter Scott, 1848), « Cette sainte nitouche de Silvère [un jeune républicain] » (Zola, 1870), « Que vous a-t-il donc fait, le petit Lagave ? Sans doute, ce n'est pas une sainte nitouche » (François Mauriac, 1928), à côté de « Cet homme [...] qui faisoit le Saint nitouche » (Pierre Lambert de Saumery, 1741), « M. de Bellegarde, qui jouait le saint Nitouche en ses lettres » (Mémoires de Gabrielle d'Estrées, 1829), « Le saint nitouche qui sans mot dire aura disqualifié d'avance deux générations d'impétrants sculpteurs et peintres itou » (Jean Frémon, 2016). Sacrée pagaille, par tous les saints !
(2) Notez l'ancienne variante : faire de la sainte nitouche.
(3) La graphie mitouche, attestée chez Voltaire, serait « une corruption de mie touche, ou plutôt de nitouche », écrivait Ménage en 1750. La première hypothèse ne paraît guère recevable, tant on sait que l'ancien adverbe de négation mie s'employait d'ordinaire après le verbe : « Ne me touche mie [= ne me touche pas] » (Le Bestiaire marial tiré du Rosarius, XIVe siècle). C'est bien plutôt sous l'influence de mite (du latin mitis, « doux ») − ancien nom populaire donné à un chat sournois et qui perdure dans chattemite pour désigner une personne affectant une contenance douce, humble et flatteuse pour tromper autrui − que le n de nitouche a pu se changer en m.
(4) Voir le billet Saint.
(5) Ce dernier point ne fait pas l'unanimité : « Une sainte-nitouche, des saintes-nitouches. On écrit aussi une sainte nitouche, des saintes nitouches, sans trait d'union » (Dictionnaire du français, Josette Rey-Debove). D'ordinaire, nous rappelle Dominique Dupriez, « saint ne prend pas la majuscule, mais est régulièrement suivi d'un trait d'union dans la formation des noms communs dérivés de noms propres (un saint-bernard [un chien] d'après le col du grand Saint-Bernard [nom propre géographique] ». L'expression sainte nitouche n'étant pas dérivée d'un nom propre, la graphie sans trait d'union paraît donc conforme à ladite règle. Reste à comprendre pourquoi les académiciens en mettent un à saint-frusquin...
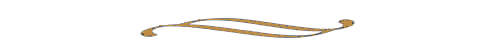
Remarque : On dit d'une personne hypocrite qu'elle fait la sainte nitouche, mais qu'elle joue les saintes nitouches (plus souvent que la sainte nitouche), à l'instar de faire la prude / jouer les prudes.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 25 Août 2017 à 12:30
Pour le linguiste Cornelis De Boer, il s'agit là d'« un cas de syntaxe figée des plus curieux ». Et de fait, nombreux sont les spécialistes de la langue qui se sont épuisés sur l'origine, pour le moins controversée, de cette locution à la forme si insolite. Car enfin, s'interroge Grevisse à bon droit, quand on écrit : « Il s'est longtemps refusé à cet arrangement ; enfin, de guerre lasse, il y a consenti », comment expliquer ce féminin lasse, accordé avec guerre, alors que manifestement c'est le personnage masculin représenté par il qui se trouve las (prononcé la), fatigué de résister ? Passons en revue les différentes hypothèses avancées.
À en croire Kristoffer Nyrop et Georges Gougenheim, ce « faux accord » serait une survivance de l'ancienne prononciation du s en position finale, lequel restait sonore devant une pause (marquée par une ponctuation) comme c'est encore le cas dans hélas ! − mot composé, est-il besoin de le rappeler, de hé et de las, au sens ancien de « malheureux ». L'oreille croyant percevoir une forme féminine et l'œil étant conforté dans ce sens par le voisinage du mot guerre, la graphie de guerre lasse se serait vicieusement imposée en lieu et place de de guerre las.
D'autres commentateurs, au XIXe siècle, arguant que ladite locution signifie proprement « quand on est las de la guerre », « après avoir longtemps résisté » et, par conséquent, que l'adjectif las ne peut ici se rapporter qu'à une personne, ont prétendu qu'il fallait écrire de guerre las ou lasse selon que le locuteur était un homme ou une femme : « À moins que vous n'apparteniez à la plus belle moitié du genre humain, ne dites pas : de guerre lasse, mais : de guerre las » (Charles Ferrand, Dictionnaire des curieux, 1880), « L'exemple donné par l'Académie est fautif, puisqu'elle dit : "Il y a consenti de guerre lasse" » (Benjamin Legoarant, Nouvelle Orthologie française, 1832). Force est de constater que ces messieurs ont fait quelques émules : « En 1880, de guerre las, Henri Brun partit pour Paris » (Émile Henriot), « De guerre las (je ne suis pas de la jaquette à traîne pour écrire "de guerre lasse") » (Frédéric Dard). Après tout, las obéissait bien aux règles d'accord de l'adjectif, à l'époque où notre expression n'était pas encore figée : « Le Roy eftant las de la guerre » (Histoire des Pays-Bas, 1643), « La Chrestienté qui estoit lasse de la guerre » (Histoire de la guerre de Flandre, 1665). Il n'empêche, observe Grevisse, écrire de guerre las « n'est sûrement pas conforme à l'usage moderne ». Qu'on en juge : « Quand toutes les intrigues, les finesses italiennes sont épuisées et déconcertées, les partis, assez forts pour combattre et trop faibles pour vaincre, font la paix de guerre lasse » (Charles Pinot Duclos, 1791), « Elle s'était livrée, de guerre lasse, à toutes sortes de charlatans » (Alexandre Dumas), « À force de m'obséder, je me rendis, de guerre lasse » (Chateaubriand), « De guerre lasse, enfin, on entre » (Musset), « Et c'est moi qui reviens à vous, de guerre lasse » (Verlaine), « Je me soumets de guerre lasse, mais en déclinant toute responsabilité » (Gide), « De guerre lasse, je quitte l'endroit » (Alain-Fournier), « Le chauffeur, de guerre lasse, avait sans doute accepté de charger un piéton persuasif » (Cocteau), « Il a résisté pied à pied, [...] et puis, de guerre lasse, il s'est rendu » (Jean Dutourd).
Pour Littré, « lasse se rapporte bien à guerre, et [...] la locution représente une figure hardie où la lassitude est transportée de la personne à la guerre : de guerre lasse, la guerre étant lasse, c'est-à-dire les gens qui font la guerre étant las de la faire ». Autrement dit, nous aurions affaire à un bel exemple d'hypallage, figure de style consistant à déplacer un terme (le plus souvent un adjectif) pour le mettre en relation avec un terme différent de celui auquel on le rattache ordinairement, le sens général de la phrase restant le même. Raoul de Thomasson, dans Les Curiosités de la langue française (1938), va plus loin, en affirmant carrément que las change de sens en changeant d'affectation. C'est que le mot ferait partie de ces adjectifs, autrefois nombreux (délicieux, mémorable, solvable, etc.), ayant (ou ayant eu) deux acceptions différentes suivant qu'ils qualifient des personnes ou des choses : « Las, fatigué en parlant d'une personne, fatigant en parlant d'une chose. Ainsi s'explique la locution de guerre lasse, qui a donné lieu aux discussions grammaticales les plus bizarres, parce qu'on se refusait à comprendre que guerre lasse veut dire guerre qui fatigue. » Pour preuve, ces anciens emplois de las en parlant d'une chose : « Quand vous saurez ceste lasse novele » (Aleschans, chanson de geste de la fin du XIIe siècle), « Je veoie le terme de ma lasse vie approucher » (Chroniques de Saint-Denis, XIVe siècle), « En la lasse journée » (Le Dit de Guillaume d'Angleterre, XIVe siècle). En latin déjà cet usage était courant, si l'on en croit Pierre Guiraud dans Les Locutions françaises (1961) : res lassæ (« les choses lasses », d'où « l'adversité »), aquæ lassæ (« les flots assoupis »). De là, extrapole le linguiste, « on peut facilement imaginer un [ablatif absolu] bello lasso dont le sens serait "par suite d'une guerre ayant épuisé ses effets et ses moyens" » et qui, traduit en français, donnerait de guerre lasse. Une attestation en bonne et due forme serait toutefois la bienvenue...
D'aucuns, sur le pied de guerre, ne manqueront pas d'objecter qu'en ancien français l'adjectif las est le plus souvent antéposé au nom de chose qu'il qualifie, alors que c'est l'inverse dans notre locution. Qu'à cela ne tienne ! Il n'est que de consulter la Toile pour s'aviser que la forme lasse guerre est bel et bien attestée, quoique tardivement, par exemple dans les Mémoires du marquis d'Argenson (milieu du XVIIIe siècle) : « Il en résultera ce que l'on appelle fin par lasse guerre » (entendez : une sorte d'armistice de fait, mais sans traité) et dans un numéro daté de 1819 du journal L'Indépendant : « Du moins les députés [...] ne se laisseront-ils pas vaincre de lasse guerre ». Voilà qui m'amène à évoquer un autre argument en faveur du rattachement de l'adjectif lasse à guerre : la locution voisine de bonne guerre, qui signifie « conformément aux règles et usages de la guerre » et se dit figurément d'un procédé habile, quoique légitime, consistant à mettre l'adversaire en difficulté et à prendre l'avantage. « J'ai fait tout ce que l'on peut faire et doit faire de bonne guerre », se serait ainsi défendu Mérigot Marchès lors de son procès au Châtelet en 1391. Aucune ambiguïté dans ce cas, vous en conviendrez : c'est bien la guerre qui est bonne − au sens militaire de « menée avec honneur, dans le respect des conventions » (1) −, pas le célèbre Limougeaud à la solde des Anglais.
Pierre Guiraud, encore lui, signale − à titre de curiosité ? − une autre théorie, selon laquelle notre locution s'analyserait sur le modèle de à cœur joie (« à [= avec] joie de cœur »), à savoir comme « "de (= par suite de) lasse de guerre" où lasse pourrait être le substantif dérivé de lasser, mot bien attesté dans l'ancienne langue avec le sens de lassitude ».
Tout bien considéré, nos spécialistes ne s'accordent en réalité que sur un point : l'expression de guerre lasse serait apparue au XVIIIe siècle, avec un premier exemple chez Saint-Simon (2). Cette unanimité peut prêter à sourire quand on sait à quel point il est difficile de dater la rédaction de chaque feuillet des Mémoires du fameux duc − disons, pour l'extrait qui nous intéresse, entre 1714 (année des évènements relatés) et 1755 (année de la mort de l'intéressé). Dans cet intervalle, d'autres attestations sont également dignes d'intérêt : « Tout aussitôt on se sépara de guerre lasse » (Journal du marquis de Dangeau... « avec les additions du duc de Saint-Simon », 1715), « Le père l'abandonna de guerre lasse » (François Gayot de Pitaval, 1731). Surtout, on n'oubliera pas de mentionner cette phrase trouvée deux siècles plus tôt sous la plume de Rabelais : « Je suis las de guerre : las des sayes [du latin sagum, "tunique de guerre"] et hocquetons [casaques portées par les hommes d'armes]. » Pourrait-il s'agir, à l'inversion près, de la forme primitive de notre locution en cours de figement (notez l'absence de l'article devant guerre) ? Las ! je ne saurais l'affirmer...
(1) Et non pas au sens courant de « plaisant, agréable », comme le donne à penser Bernard Pivot, un rien démagogue, dans un tweet daté d'août 2015 : « Une expression détestable : "c'est de bonne guerre". Il peut y avoir des guerres inévitables ou justes, il n'en est point de bonnes. »
(2) « Des paroles aussi expressives de la violence extrême soufferte, et du combat long et opiniâtre avant de se rendre, de dépit et de guerre lasse, aussi évidentes, aussi étrangement signalées, veulent des preuves aussi claires, aussi précises qu'elles le sont elles-mêmes. »
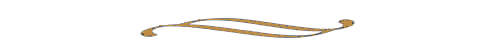
Remarque 1 : Faute d'avoir trouvé trace, dans le Roman de la Rose, des graphies auxquelles l'auteur fait référence, je ne m'étendrai pas sur la thèse, rapidement évoquée par Thomasson, selon laquelle de guerre lasse serait la forme altérée de de querre lasse, comprenez : las (lasse) de querre, ancienne forme de quérir (« chercher »).Remarque 2 : Sur le front du niveau de langue, la locution de guerre lasse a également fait l'objet de jugements contradictoires : « Figuré et familier » (huitième édition du Dictionnaire de l'Académie), « Elle semble avoir toujours eu un usage plus littéraire que réellement populaire » (Claude Duneton).

 5 commentaires
5 commentaires
-
Par Marc81 le 8 Juillet 2012 à 17:25
Aux jeux de dames et d'échecs, lorsque l'on parvient à pousser un pion jusqu'à la dernière ligne adverse, on le dame (on dit aussi aller à dame), c'est-à-dire qu'on transforme ledit pion en dame (ou en toute autre pièce de valeur, roi excepté, aux échecs) dans l'espoir de tirer profit de cet avantage souvent décisif.
Damer le pion à quelqu'un est une expression familière empruntée de ces jeux, qui signifie « l'emporter sur lui avec une supériorité marquée », « lui souffler la victoire ».
Il pensait être pionnier dans son domaine, mais un concurrent lui a damé le pion.
On se gardera de toute confusion avec l'autre acception du verbe damer (« aplanir, tasser avec une dame », comme dans damer la neige) ou encore avec le verbe damner, à l'instar de ce plaisant quiproquo relevé dans Le Point no 2072 (mai 2012) sous la plume de François Musseau : « Rien n'était trop grand pour des dirigeants politiques décomplexés se targuant de damner le pion à la Catalogne voisine ». Un projet diabolique ?...

(photo Wikipédia sous licence GFDL par Michel32NI) votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 5 Janvier 2012 à 23:11
Ceux qui écrivent et prononcent à corps et à cri commettent à la fois un contresens et une faute de liaison. Ils ignorent manifestement l'origine de cette expression, empruntée à la chasse à courre (ancienne forme du verbe courir) et non à l'anatomie humaine.
Chasser à cor et à cri, c’est chasser avec grand bruit, en faisant sonner le cor (l'instrument à vent encore appelé trompe) et aboyer les chiens, d’où le sens figuré de « (vouloir, exiger, poursuivre une chose) à toute force, en insistant bruyamment ».
Les militants réclament une augmentation à cor et à cri (= avec insistance).
En revanche, on se lancera dans la bataille à corps perdu (= avec impétuosité, sans se ménager) ou à son corps défendant (= malgré soi). Dans les deux cas, les cris sont en option.
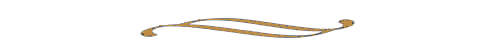
Remarque 1 : En l'espèce, la confusion entre les homophones cor et corps provient sans doute de l'influence de l'expression (se donner, se vouer, se consacrer) corps et âme, c'est-à-dire sans réserve, de toutes ses forces.Remarque 2 : En tant que locution adverbiale figée, l'expression à cor et à cri ne prend pas la marque du pluriel, en dépit de quelques exemples relevés ici ou là (notamment dans le Dictionnaire historique de la langue française qui écrit : à cor et à cris).
Remarque 3 : On appelle hallali (composé d'une forme conjuguée de haler, « exciter les chiens », et de a li, « à lui ») le cri des chasseurs ou la sonnerie de trompe annonçant que l'animal poursuivi est sur ses fins. Au figuré, ce nom masculin désigne les derniers moments d'une lutte, où va succomber l'un des adversaires (sonner l'hallali). Quant à la curée (altération de cuirée, dérivé de cuir, « peau », car ce que l'on donnait à manger aux chiens était disposé sur le cuir de la bête tuée et écorchée), il s'agit des bas morceaux que l'on donne en pâture aux chiens une fois le gibier abattu et, par métonymie, le fait de donner cette pâture, le moment où on la donne (au figuré : lutte avide pour s'emparer des places, des honneurs, des biens laissés vacants).
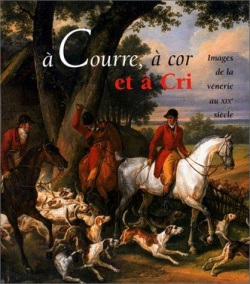
La vénerie (ou vènerie selon les Rectifications orthographiques) est encore appelée « chasse à courre, à cor et à cri ».
(Éditions Somogy) 3 commentaires
3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Richesse et difficultés de la langue française





