-

« La collection [La Pléiade], où les grands génies se vêtissent des meilleurs cuirs, a été fondée en 1931 par l’éditeur Jacques Schiffrin, et rachetée par Gallimard peu après. »
(David Caviglioli, sur nouvelobs.com, le 13 septembre 2018)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en penseÀ ce train-là, notre journaliste risque de se prendre une veste grammaticale. Car enfin, il n'aura échappé à personne − à commencer par la correspondante qui m'a signalé ce vêtissent de curieuse facture − que vêtir est un verbe du troisième groupe qui, partant, ne se conjugue pas comme finir : il (se) vêt, ils (se) vêtent, ils (se) vêtaient, (se) vêtant, et non pas il (se) vêtit [forme qui appartient au passé simple], ils (se) vêtissent, ils (se) vêtissaient, (se) vêtissant.
Seulement voilà : ces variantes empruntées à la deuxième conjugaison se rencontrent depuis belle lurette sous des plumes que l'on ne saurait qualifier d'endimanchées. Jugez-en plutôt : « Quand vous vêtissez les pauvres, il [Jésus-Christ] est vêtu » (Bossuet, avant 1704), « [Des pauvres] qu'elle nourrissoit et vêtissoit tous » (Saint-Simon, 1707), « Dès qu'un homme s'en vêtissait » (Montesquieu, 1734), « Des étoffes dont ils se vêtissent » (Buffon, vers 1760), « Le cocotier qui ombrage, loge, vêtit, nourrit, abreuve » (Voltaire, 1772), « Ces haillons troués qui la vêtissent à demi » (Diderot, 1772), « De leurs molles toisons les brebis se vêtissent » (Jacques Delille, 1805), « [Elle] prenait sa robe et se la vêtissait » (Paul-Louis Courier, 1810), « Car les chevriers se vêtissent de peaux de bêtes » (Hugo, 1823), « Ma mère [...] vêtissait l'indigence ou nourrissait la faim » (Lamartine, 1830), « L'air est là, [...] vêtissant la terre » (Sainte-Beuve, 1834), « Ils se vêtissent de diverses couleurs » (George Sand, 1837), « [Les mauvais pasteurs] se vêtissent de leur laine [celle des brebis] » (Lamennais, 1846), « Les sauvages vivaient et se vêtissaient du produit de leurs chasses » (Chateaubriand, avant 1848), « Il faut qu'il se vêtisse » (Adolphe Thiers, 1848), « Mon habit n'est pas très beau, dit-il en se vêtissant » (Henry Murger, 1849), « Les personnages importants que vêtissaient ces robes » (Alexandre Dumas, 1851), « Aimons-la, nourrissons-la, vêtissons-la » (Hugo, 1864), « Les feuilles sèches vêtissaient la futaie d'admirables teintes fauves » (Paul Bourget, 1887), « Le drap grossier dont se vêtissait le populaire » (René Bazin, 1900), « Un vêtement de soleil vêtissait son âme » (Édouard Estaunié, 1908), « La vipère que je vêtis » (Paul Valéry, 1922), « En attendant qu'on me vêtisse » (Céline, 1936), « Mais le réveiller, qu'il se vêtisse ! » (Jean de La Varende, 1941). Que du beau linge, convenons-en !
« Évidemment, observait non sans malice Abel Hermant en 1935, les fautes des grands n'excusent pas celles des petits ; mais il est toujours agréable de pouvoir resservir à Montesquieu ou à Voltaire [...] le vieux proverbe de la paille et de la poutre. » Sauf que tout porte à croire qu'il ne s'agissait pas là à proprement parler de fautes ! Figurez-vous qu'il était courant, dans l'ancienne langue, que les verbes en -ir d'origine latine hésitassent entre deux conjugaisons : l'une conforme à celle des verbes latins en -ire et l'autre qui s'en distinguait par l'introduction à certains temps de la syllabe -iss-, sur le modèle des verbes inchoatifs en -iscere (2). Vêtir (d'abord vestir, emprunté du latin vestire) ne fut touché par ce phénomène qu'assez tardivement ; rares en moyen français, les formes inchoatives dans la conjugaison dudit verbe devinrent plus fréquentes à partir du XVIe siècle, sans toutefois prendre le pas sur les graphies traditionnelles : « Mondes, tu vestis de samis [soie] Le cors » (Watriquet de Couvin, avant 1329), « Non pas que touzjours les vestisse » (Guillaume de Digulleville, milieu du XIVe siècle), « Il se vestissoit à la mode des Grecs » (Nicole Gilles, 1490), « Les vignes de Malthe ne vestissent tant de persones » (Rabelais, 1546), « Roland s'habille en diligence. Il vêtit son harnois » (Philippe Desportes, 1572), « La jument apte au char et frein Te hennit, de pourpre africain Les laines te vestissent » (Luc de La Porte, 1584), « Tous ceux qui boivent le laict et vestissent la laine des brebis » (Bernard Palissy, avant 1590), « La on ne reschauffe plus les refroidis, la on ne vestit plus les nudz » (François de Sales, 1594), « Je suis d'advis que maintenant, Monsieur, [...] Vous vestissiez chemise blanche » (Jean Godard, 1594), « Un noble et généreux cœur ne peut mentir ny faillir, en quelque lieu qu'il se treuve, ny quelque robbe qu'il vestisse » (Pierre de Bourdeille, avant 1614), « Puis de sa tendre peau faut que l'enfant vestisse Le meurtrier de son Père » (Agrippa d'Aubigné, 1616). En 1618, Charles Maupas donnait encore les deux conjugaisons dans sa Grammaire : « je vests ou vestis, j'ay vestu ou vesti, vestant ou vestissant », avant que Vaugelas (et l'Académie à sa suite) ne taillasse un costard façon Fillon aux formes en -iss- du composé revêtir : « Il faut dire revestant, revestons et non pas revestissant, revestissons. » (3) La famille de vêtir venait d'être habillée pour l'hiver... mais pas pour l'éternité. Ne lit-on pas à l'article « vêtir » de l'édition de 1820 du Nouveau Dictionnaire de Jean-Charles Laveaux : « Les pauvres gens se vêtissent de bure » et à celui de l'édition de 1823 du Dictionnaire de Pierre-Claude-Victor Boiste : « Un homme d'esprit appelait son corps, sa bête : il la vêtissait, la nourrissait, la promenait, la soignait avec attention » ? Et encore, à partir de 1870, dans le Grand Larousse du XIXe siècle : « Les quatre angles [...] vêtissent l'écu » (à l'article « écu »), « Ne se vêtissant que de haillons sordides » (à l'article « Mitford [John] »).
C'est que, nous disent en substance les partisans de la conjugaison inchoative, celle-ci a sur sa rivale deux avantages considérables : la régularité et l'euphonie. Ainsi Sainte-Beuve, conscient de l'entorse faite à la règle, confessait-il à propos de l'exemple cité plus haut : « On en demande pardon [...] à la grammaire, mais l'expression nous a semblé commandée ; vêtant, qui passe pour exact, n'est pas possible. » Il est vrai qu'avec ses allures d'injonction à déguerpir (Va-t'en !) ledit participe présent peut heurter les âmes sensibles et les oreilles délicates... C'est encore au nom de l'euphonie que Gide prônait une certaine tolérance pour les formes calquées sur la deuxième conjugaison : « Vêtissait est assez difficile à défendre ; mais dans certains cas, il paraît tellement plus expressif et plus beau que vêtait, qu’on ne s’étonne pas qu’il ait été préféré par Lamartine [...] ; je ne le repousserai pas s’il vient naturellement sous ma plume (4) » (Incidences, 1924). Ce serait donc là affaire de goût. Les grammairiens eux-mêmes semblent partagés ; si la plupart crient au barbarisme (5), certains, à la fibre plus conciliante, se mettent à filer un mauvais coton : « Ce serait pousser le rigorisme au-delà de ses bornes, concède Léonard Casella dans son Traité complet de la lexigraphie des verbes français (1838), que de ne pas admettre, après d'aussi imposantes autorités, ces expressions bien plus agréables à l'oreille que celles si sourdes de vêt, vêtent, vêtant, seules admises jusqu'à ce jour par les grammairiens dans la [conjugaison] de ce verbe. Nous croyons cependant que dans les composés de ce verbe l'emploi du radical primitif vêt est préférable : il revêt, en revêtant. » (6) La bienveillance se mue en un enthousiasme aux accents révolutionnaires sous la plume du réformateur F. Dégardin : « Ne disons donc plus vêtant, je vêts, je vêtais, que je vête (ce qui est bien un peu baroque) ; mais vêtissant, je vêtis, je vêtissais, etc. Ne craignons pas de parler comme Voltaire, Buffon, Delille, Lamartine, etc. ; et déplorons la témérité des critiqueurs maladroits qui se sont permis de condamner ces immortels écrivains » (Les Homonymes et les homographes de la langue française, 1857). Jules Dessiaux se montre plus mesuré : « Si nous consultons l'Académie et les grammairiens qui ont parlé de la conjugaison du verbe vêtir, nous n'hésiterons pas à dire que vêtissait est un barbarisme, et qu'il fallait dire vêtait [...]. Mais, si nous ne consultions que les écrivains, nous serions tenté de croire que ce verbe a deux participes présents : vêtant et vêtissant. [...] Malgré les exemples [des écrivains], nous croyons que cette conjugaison n'est pas encore assez autorisée ; mais il faut avouer que ce n'est pas là un grossier barbarisme » (Journal de la langue française, 1839). Autorisée, la conjugaison inchoative de vêtir l'est assurément pour Gabriel-Henri Aubertin, qui la met à l'honneur dans sa Grammaire moderne des écrivains français (1861) en l'assortissant de cette remarque édifiante : « Vieil imparfait : Je vêtais. Aujourd'hui vêtissais ». Plus près de nous, Albert Dauzat observe, dans Phonétique et grammaire historiques de la langue française (1950), que, « si vêtis pour vêts est encore rare, vêtissons... vêtissent est devenu courant chez les écrivains, à part de rares puristes », lesquels s'obstinent, renchérit Charles Bruneau, « à imposer, après Vaugelas, je vêts, je vêtais, qui sont inusités » (Précis de grammaire historique de la langue française, 1956) ; quant à Grevisse, il endosse, comme souvent, la livrée du Suisse de service : « Je n'irai pas jusqu'à recommander [...] de prendre à sa guise vêtir comme verbe inchoatif. Mais je ne condamnerai pas non plus ceux qui, à l'occasion, se plairaient à le faire » (Problèmes de langage, 1970). D'autres enfin parlent de licence poétique (Henri Rochefort, Moritz Regula) ou, à l'inverse, de déformation populaire façon Zazie dans le métro : « − Eh bien vêtez-vous. – Vêtissez-vous, ma toute belle. On dit : vêtissez-vous » (Raymond Queneau, 1959).
De tous ces arguments l'académicien Roger Peyrefitte se moquait comme de sa première chemise : « Si Voltaire, Diderot et Hugo ont écrit "vêtissent" ou "vêtissait" pour "vêtait" et "vêtent", il serait absurde de s'en autoriser », lit-on dans son roman L'Illustre Écrivain (1982). Autrement dit, les caprices de nos auteurs, fussent-ils taillés dans la plus belle étoffe, ne suffisent pas à autoriser des formes contraires à l'usage général. Mais de quel usage parle-t-on ? De celui qui a maintenu à vêtir, dévêtir, revêtir les formes anciennes sans -iss-, mais qui, retournant sa veste, conjugue les composés savants investir, travestir sur le modèle de finir ? (7)(8) Allez comprendre... En attendant, le commun des vêtus s'en tiendra prudemment à la conjugaison traditionnelle de ce traître de vêtir plutôt que de risquer de s'attirer les foudres des sages en habits verts.
Mon petit doigt me dit que le concurrent habiller, aux formes conjuguées moins mal fagotées, a de beaux jours devant lui...(1) Et aussi : « Ils achètent les habits des pestiférés, s'en vêtissent » (Montesquieu, 1748), « Toutes ces peuplades [...] se vêtissent de peaux de bêtes » (Voltaire, 1756), « La fausse pudeur qui autrefois vêtissait les femmes » (Pierre-Louis Roederer, 1799), « Les sillons [...] se dépouillent et se vêtissent » (Lamartine, 1830), « Il vêtit celui qui est nu, mais il ne le réchauffe pas dans son sein » (Chateaubriand, 1831), « Les ombres les [les montagnes de la Grèce] vêtissent » (Lamartine, 1832), « Les plus larges feuilles [...] vêtissaient les arbres » (Sainte-Beuve, 1834), « Car le maître au moins nourrit, loge, vêtit son esclave » (Lamennais, 1836), « Comme un fils de Morven me vêtissait d’orages… » (Lamartine, 1836), « Secourant le malheureux, nourrissant le pauvre, vêtissant l'orphelin » (Chateaubriand, avant 1848), « [Le soleil] qui le vêtissait de son auréole de rayons » (Lamartine, 1851), « Il se vêtissait de la nuit » (Hugo, 1862), « Un grand lit large et bas, que vêtissait une couverture rouge » (Paul Acker, 1901).
(2) Étienne Le Gal nous explique en quoi consiste la conjugaison inchoative et comment elle naquit : « Les Latins possédaient des verbes nombreux en scere, sco (formes esco, isco, asco, osco) qui exprimaient le commencement d'une action, et qu'on appelait pour cela inchoatifs (latin inchoativus, de inchoare, "commencer"). Ces verbes en sco prirent une très grande extension vers la fin de l'Empire, si bien que beaucoup de verbes anciens en ēre, ère ou ire eurent, à côté de leur forme normale, une forme inchoative en scere, sco, ou adoptèrent uniquement cette dernière forme. La terminaison inchoative scere, sco pénétra ainsi les trois conjugaisons latines et elle devint le type d'une conjugaison qui s'étendit bientôt à la plupart des verbes en ire. C'est ainsi que finire donna la forme finiscere. Cette conjugaison inchoative en scere, sco, se généralisa dans le passage du latin au français, et elle nous donna un très grand nombre de verbes. Ces verbes eurent, par suite, entre leur radical et leur terminaison, à certains modes une syllabe intercalaire iss, venue de la particule inchoative latine isc [...]. L's, étant fort, se double devant une voyelle et s'amuït au contraire devant une consonne. C'est ainsi que l'on écrit : nous finissons, il finit. [...] Il n'y a donc pas là un barbarisme [à propos des formes vêtissent, vêtissaient...] ; il y a tout simplement un exemple de conjugaison inchoative. Mais l'usage impose : vêtent, vêtaient » (Ne dites pas... Mais dites... : Barbarismes, solécismes, locutions vicieuses, 1925).
(3) Comme vêtir, les composés dévêtir, revêtir eurent tendance à emprunter la conjugaison inchoative (de type finir) : « Il fait les bleds heureux, De pampre il revestit les raisins plantureux » (Joachim du Bellay, 1558), « Qui despouille la haine de Dieu se revestist de la haine de nous » (Montaigne, 1569), « Il se devestissoit de sa Chanoinie » (François du Tillet, 1605), « On revestit ses pensées [de] paroles » (Bossuet, 1697), « Une cascade de Marli dont les membres revêtissent à présent les chapelles de Saint-Sulpice » (Diderot, 1759), « C'est une bière dont on revêtit un cadavre » (Turgot, avant 1781), « C'est alors que les zéphyrs [...] la revêtissent de la robe du printemps » (Bernardin de Saint-Pierre, 1784), « En te revêtissant d'une forme dernière » (Antoine Le Bailly, 1823), « Pendant qu'elle se dévêtissait » (Alphonse Allais, avant 1902), « Le curé se dévêtissait des ses habits sacerdotaux » (Apollinaire, 1910), « Les magistrats [...] revêtissent les apparences du journaliste, du député, de l'orateur » (Paul Adam, 1910), « Il y a une nudité avant que l'on se re-vêtisse » (Paul Valéry, 1941).
(4) À en croire Paul Léautaud, ce fut le cas dans la première mouture de Si le grain ne meurt : « Gide dit : "[Paul] Souday me reproche jusqu'à des fautes de français, parce que j'ai écrit quelque part dans ce livre : vêtissait, au lieu de vêtait. On peut dire l'un ou l'autre [...], que diable !" » (Journal littéraire, 1958).
(5) « Vêtissoit est un barbarisme échappé du reste à plusieurs grands écrivains, qui ont oublié l'irrégularité de ce verbe » (Louis Charles Dezobry, 1844), « Si le génie, fût-il Voltaire, [...] conjugue vêtir à tous ses temps comme finir, je ne l'excuserai point en avançant que les grands écrivains font ce verbe régulier [...] ; je prononcerai hardiment le mot barbarisme » (L. Samuel Colart, Nouvelle Grammaire française, 1848), « Vêtissait est un barbarisme » (Joseph Chantrel, Cours abrégé de littérature, 1872), « Il n'en faut pas moins considérer ces formes comme des barbarismes » (Éman Martin, Le Courrier de Vaugelas, 1870). Littré (1872) parle de « faute contre la conjugaison », Pierre Le Goffic (1997) de « formes déviantes par attraction de la deuxième conjugaison » et Bescherelle (2012) de « formes fautives ».
(6) Réponse cinglante dans le numéro de mai 1838 du Journal de la langue française : « Il y a en grammaire plusieurs considérations qui doivent avoir le pas sur celles de l'euphonie. Les noms cités par M. Casella sont sans doute très imposants, mais nous ne trouvons pas là une raison suffisante pour admettre de gaîté de cœur la consécration d'un solécisme. Outre la violation manifeste de l'ancienne et rationnelle lexigraphie de ce verbe [vêtir], la nouvelle orthographe présenterait encore l'inconvénient de confondre les trois premières personnes de l'indicatif présent avec les trois premières du prétérit défini [n'est-ce pas déjà le cas de tous les verbes du deuxième groupe ?]. Et pourquoi cette perturbation dans l'économie d'un verbe qui fonctionne parfaitement bien ; perturbation qui en amènerait nécessairement une autre dans ses trois dérivés ? pour excuser trois ou quatre [!] grands écrivains et favoriser l'ignorance d'une foule d'écrivains médiocres. Cet usage, qui ne date pas de loin [!], doit être combattu, et nous croyons que ce serait naturellement nuire à la langue que de le favoriser. »
(7) La logique veut que la même différence se trouve dans les noms dérivés de ces verbes : vêtement, dévêtement, revêtement, mais investissement, travestissement. Il n'est pourtant que de consulter les anciennes éditions (1762-1835) du Dictionnaire de l'Académie pour prendre les Immortels la main dans le sac (de linge sale) : ne préconisaient-ils pas la graphie dévêtissement tout en indiquant par ailleurs que « dévêtir se conjugue comme vêtir » ? Là encore, comprenne qui pourra...
(8) Aussi le philologue Jean Bastin ne voyait-il « aucun mal à ce que vêtir se conjugu[ât] comme son composé investir » (Précis de phonétique, 1905).
Remarque 1 : Selon Dupré, « les difficultés de conjugaison de vêtir sont si réelles que de grands écrivains s'y sont trompés ». On peine à croire que toutes les plumes citées plus haut ignorassent à ce point leurs conjugaisons... Littré voyait plutôt dans cette « confusion » l'influence du « composé investir [qui] suit la conjugaison ordinaire ». Les témoignages de Sainte-Beuve et de Gide attestent pourtant une autre réalité : l'emploi des formes inchoatives de vêtir ressortit davantage à un choix esthétique, formel qu'à la confusion ou à l'analogie.
Remarque 2 : « Si vêtir était resté dans la langue courante, il aurait pris vraisemblablement la conjugaison inchoative », écrivait Léon Clédat en 1913. Hypothèse hasardeuse, me semble-t-il, dans la mesure où des verbes d'usage courant comme dormir, sentir... ont conservé leurs formes traditionnelles.

Ce qu'il conviendrait de dire
Les grands génies se vêtent (selon l'Académie et les dictionnaires usuels).
On notera, au demeurant, que la forme vêtissent initialement employée a été promptement remplacée, dans l'article de L'Observateur, par l'irréprochable vêtent. 1 commentaire
1 commentaire
-
C'est en toute discrétion que l'Académie a modifié, à l'article « pouce » de la dernière édition de son Dictionnaire, une définition qui n'avait pas varié d'un... pouce depuis 1835 : de « Figuré et familier. Manger, déjeuner sur le pouce, À la hâte, sans prendre le temps de s'asseoir », on est passé à « Figuré et familier. Manger, déjeuner sur le pouce, à la hâte et légèrement ». Exit l'idée de se tenir debout, au profit de celle de faire un repas léger. Seulement voilà : Larousse ne mange pas de ce pain-là et s'en tient au traditionnel « à la hâte et sans s'asseoir », tandis que Robert donne à la variante manger un morceau sur le pouce le sens de « sans assiette et debout ». Quant au précieux site de l'ATILF, il n'y a aucun coup de pouce à attendre de sa part ; n'écrit-il pas d'une main : « Prendre un repas debout et sans couvert ; par extension, consommer à la hâte » (côté TLFi) et de l'autre : « Manger peu et vite » (côté Base historique du vocabulaire français) ? Avouez qu'il y a de quoi perdre son latin en plus de l'appétit... Mais au fait, me demanderez-vous les mains écartées en signe d'incompréhension, que vient faire le pouce dans cette affaire ? Selon Alain Rey et Sophie Chantreau, qui connaissent les locutions françaises sur le bout des doigts, l'expression fait sans doute référence « au rôle des pouces dans le maniement du couteau et du pain tranché, et très probablement à la nourriture rapidement poussée ». Vous, je ne sais pas, mais moi, je reste sur ma faim...
Renseignements (de première main) pris, l'expression employée à l'origine est, contre toute attente, morceau sous le pouce ; on la trouve, avec un degré de figement plus ou moins élevé, dans une lettre datée de 1777 et attribuée à Jean-Marie Roland de La Platière : « [Une omelette] dont chacun tiroit son morceau sous le pouce », puis dans Le Bonheur champêtre (1782) de Nicolas de Bonneville : « On vous prend sous son pouce un bon morceau de lard » et, surtout, sous la plume réputée légère du romancier Pigault-Lebrun : « Je mangeai un morceau sous le pouce » (1792), « Allons, à table, un morceau sous le pouce, une bouteille à la régalade » (1794), « Après le morceau sous le pouce, on s'était remis à patiner » (1799), « ll demanda qu'on lui apportât un morceau sous le pouce » (1804). Dans son Voyage de Bourgogne (1777), le poète Antoine Bertin nous donne une description pittoresque de cette pause-déjeuner : « Dépourvus de fourchettes, je m'imagine qu'on aurait pu très plaisamment nous peindre, pressant du pouce une cuisse ou une aile de poulet sur un morceau de pain, taillé en forme d'assiette. » Deux siècles plus tard, la même scène est évoquée de main de maître par l'écrivain Georges Bordonove dans Les Tentations (1960) : « Jean se mit à manger comme les paysans : le pain dans le creux de la paume, un morceau de grillon sous le pouce, le couteau dans la main droite. Il se coupait une bouchée. » (1) Vous l'aurez compris, le morceau sous le pouce − ellipse pour « morceau (de poulet, de jambon, de lard, d'omelette, de fromage...) (posé sur une tranche de pain faisant office d'assiette et tenu) sous le pouce » − désigne proprement (si j'ose dire) la nourriture (généralement froide) mangée à la façon des milieux populaires, c'est-à-dire saisie avec les doigts et coupée en tranches ou en bouchées avec un couteau, par opposition à celle servie dans une assiette individuelle et piquée à l'aide d'une fourchette : « C'est un morceau sous le pouce : nous n'avons pas de vaisselle » (Pigault-Lebrun, 1794), « Je me fais donner [...] un morceau sous le pouce » (Alphonse-Aimé Beaufort d'Auberval, 1803), « Un morceau sous le pouce ne vous ferait pas de tort » (Jean-Toussaint Merle, 1813), « − Si vous voulez prendre quelque chose, en attendant le dîner... − Très volontiers, un morceau sous le pouce, une tranche de jambon » (Armand Gouffé, 1817), « Je mangerai un morceau sous le pouce » (Prosper Mérimée, 1833), « Vivre à ton aise, avec un morceau de lard sous le pouce et un verre de vin devant toi » (Émile Souvestre, 1835). C'est au prix d'une seconde ellipse qu'apparut, au début du XIXe siècle, le tour manger sous le pouce pour « manger un morceau sous le pouce » : « Il met à l'abri ses couverts en faisant manger sous le pouce » (Antoine Antignac, 1807), « [Il] se livrait, en mangeant sous le pouce, à de joyeuses saillies » (Georges Touchard-Lafosse, 1838) (2).
Figurez-vous que ledit morceau, prenant son courage à deux mains, chercha de bonne heure à se hisser sur le pouce. Quelle drôle d'idée ! s'exclameront les beaux esprits avec des airs de sainte nitouche. Car enfin, comment manger avec la viande ou le fromage sur le pouce ? C'est aussi stupide que vouloir se mettre quelque chose sur la dent ! À la réflexion, je vois bien trois explications à pareille acrobatie. La première est d'ordre mécanique : d'aucuns arguent que, si le morceau se situe sous le pouce quand on le presse sur une tranche de pain, la lame du couteau, elle, vient buter sur le plus gros doigt de la main qui s'apprête à tailler l'ensemble en bouchées (3) ; autrement dit, on maintient sous le pouce d'une main ce que l'on coupe sur le pouce de l'autre − question de point de vue. La deuxième, avancée par Éman Martin dans Le Courrier de Vaugelas (1874), est d'ordre historique : attendu que le r ne se prononçait pas, dans l'ancienne langue, à la fin des mots en our, il n'était pas rare que sour et souz (ancêtres de nos actuels sur et sous) soient employés l'un pour l'autre ; nous pourrions donc nous trouver devant un cas analogue (quoique inversé) à celui des locutions sous condition, sous peine, autrefois concurrencées par les variantes sur condition, sur peine. La troisième est d'ordre analogique : l'influence de l'expression voisine manger sur le poing, attestée à la fin du XVIe siècle (et depuis tombée en désuétude) au sens de « être très familier », par allusion aux rapaces dressés à venir manger sur le poing du fauconnier, n'est peut-être pas à exclure. Toujours est-il que c'est la graphie sur le pouce qui finit par l'emporter sur sa concurrente, malgré les protestations d'une grosse poignée de spécialistes : « Ne dites pas : Manger un morceau sur le pouce, dites : sous le pouce » (Florimond Parent, 1831 ; Félix Biscarrat et Alexandre Boniface, 1835 ; Mesdemoiselles Clair, 1838 ; D. Gilles, 1858 ; George Verenet, 1860), « L'expression sur le pouce est inintelligible, car le pouce qui tient le morceau de viande sur le pain est dans une position telle que la viande, elle, se trouve dessous » (Benjamin Legoarant, 1858), « On dirait mieux peut-être : sous le pouce » (Dictionnaire analogique de Prudence Boissière, 1862), « Du pain et du fromage sur le pouce ou plutôt sous le pouce » (Alexandre Dumas, 1864), « M. Théodore Braun [a] copieusement traité la grave question de savoir s'il faut dire manger sur le pouce ou, comme il le propose et soutient envers et contre tous les lexicographes, manger sous le pouce » (Joseph Coudre, 1887), « Littré dit, sans le corriger, un morceau sur le pouce. Il faut dire : sous le pouce, l'objet est pris entre le pouce et le pain » (Édouard Le Héricher, 1888), « Sur le pouce est pour sous le pouce » (Dictionnaire des locutions proverbiales, 1899), « [Ils] se faisa[ie]nt servir le matin quelque morceau de viande qu'ils mangeaient sous le pouce (ainsi disait-on, et l'expression était juste) » (Germaine et Georges Blond, 1960), « En breton, on mange sous le pouce ce qui est plus logique que l'expression française "manger sur le pouce" » (Patrick Hervé, 1994).
Pourquoi l'Académie (et à sa suite Gattel, Landais, Bescherelle, Poitevin, Littré, Larousse et Robert [4]) a-t-elle fait la sourde oreille, balayant ces objections d'un revers de la main ? (5) Je donne ma langue et mes pouces au chat. Quant à ceux qui, à l'instar de Louis Lamy, soutiennent mordicus que « les travailleurs peu fortunés, obligés de se contenter d'un morceau de pain et d'un peu de fromage, tiennent leur couteau dans la main droite, le pain de la main gauche, et le fromage placé sur le pouce de cette dernière » (Le Pêle-Mêle, 1899), je les invite à se demander pourquoi les attestations de morceau sur son pouce (avec le possessif indiquant un emploi littéral) ou posé (placé, mis, découpé...) sur le pouce ne se comptent que sur les doigts d'une main (6). Peu importe la préposition, en vérité, dans la mesure où l'idée reste la même, à savoir manger avec les doigts, sans façon, sans cérémonie (comme le paysan dans son champ, l'ouvrier sur son chantier ou le soldat dans sa tranchée), en se contentant le plus souvent de ce qui tombe... sous la main : « N'faut pas faire de façon ; c'est sans cérémonie. À la cuisine, là, un morceau sur le pouce » (Louis Tolmer, 1798), « Vous êtes ben cérémonieuse, je vas prendre un morceau sur le pouce avec lui » (Joseph Aude, 1804), « Tu te passeras de serviette et d'assiette aussi. Un morceau sur le pouce, sans façon » (Maurice Ourry, 1811), « Je n'ai pas d'assiettes, [...] mes pensionnaires ont la complaisance de manger sur le pouce » (Alphonse Martainville et Théophile Dumersan, 1812), « Nous dînâmes sans nappe, c'est-à-dire, morceau sous le pouce » (Philippe Petit-Radel, 1815), « Mais, pas de façon : un morceau, là, sous le pouce » (Jacques-Francois Ancelot, 1830), « Il vit de pain et de cervelas ; et il mange sur le pouce » (François-Vincent Raspail, 1831), « L'acheteur les [= des brochettes de mouton] emporte sur une [galette de pain] et les mange sur le pouce » (Lamartine, 1835), « [Ces demoiselles] ne firent aucune façon pour les [= des morceaux de pâté] prendre et les manger sous le pouce avec les tranches de pain que le bourgeois taillait » (Alexis Eymery, 1838), « Le jeune prince [...] n'a pas été habitué à se servir de ses doigts comme d'une fourchette, et à manger sur le pouce » (Étienne Rousseau, 1862), « − Comment voulez-vous que je déjeune ? je n'ai ni serviette, ni fourchette, ni assiette. − Nous non plus ! On mange avec son couteau, sur le pouce » (Victorien Sardou, 1862), « La servante [...] n'avait point d'assiette, recevait sa part sur son pain et mangeait sous le pouce, avec la pointe du couteau qui lui servait de fourchette » (Henri-Edme Bouchard, 1867), « La société mangeait sur le pouce, sans nappe et sans couverts » (Zola, 1876), « On ne dressait pas la table ; on mangeait "sous le pouce" » (Laurent Tailhade, 1905), « Gambaroux mange sans assiette, sur le pouce, son morceau de pain dans la main gauche, avec la viande ou le fromage par-dessus, son couteau à grande lame pointue dans la main droite » (Jules Romains, 1934).
De ce sens primitif on est facilement et rapidement passé à celui de « repas pris en vitesse » : car à moins de partir pique-niquer, pourquoi irait-on manger avec les pouces, sans prendre la peine de dresser la table, si ce n'est parce qu'on n'a pas trop le temps de se les tourner ? (7) Cette extension de sens (selon le TLFi) ou cette acception figurée (selon l'Académie) s'est manifestée avant 1829, date à partir de laquelle apparaissent les premiers emplois de sur le pouce à propos d'une boisson, d'un potage ou de tout autre mets liquide : « Je suis déjà en retard, tout ce que je puis c'est de prendre un petit verre sur le pouce » (Mémoires de Vidocq, 1829), « − Voulez-vous [...] une chopine, sur le pouce ? − Sur le pouce ? volontiers, car je n'ai pas le temps » (Ibid.), « On vidait sur le pouce une feuillette [= tonneau de vin] » (Pétrus Borel, 1840), « Boire plus d'un canon sur le pouce » (Lamothe-Langon, 1840), « J'ai pris un potage sur le pouce, au Café de Paris » (La Presse, 1848), « Vous accepterez bien un verre d'eau de cidre sous le pouce ? » (Lucien Thomin, 1885), « Versez, père Maluron, et sur le pouce [...], j'veux pas prendre racine ici » (Jean Lorrain, 1904), « Nous soupons vite, sur le pouce, pas très intéressés par la mangeaille » (Jean Giono, 1951), « Un coup sur le pouce et on y va » (Jean-Noël Blanc, 1988). Il n'est que trop clair, dans ces exemples, qu'il ne s'agit plus de jouer des pouces plutôt que des couverts, mais de boire rapidement un coup. C'est cette idée secondaire de hâte − plutôt que celles, absconses, parfois avancées : « Manger sous le pouce, antiphrase qui veut dire sur les pieds » (Le Figaro, 1831), « Si le pouce désigne un doigt de la main, il désigne tout autant un doigt de pied. Et si sur le pouce voulait tout simplement dire "debout" ? » (Jean-Damien Lesay, 2013) − qui a pu induire celle d'être debout. Et pourtant... Qui ne verrait que la position du morceau de viande par rapport au pouce ne nous renseigne en rien sur celle de la personne qui s'apprête à l'avaler ? Manger avec les doigts, convenons-en, peut s'envisager debout ou assis (quoique rarement sur une chaise, il est vrai), avec ou sans table (8) ; aussi se félicitera-t-on du récent revirement de l'Académie sur ce point. Pour autant, était-elle fondée à mettre en avant l'idée de repas léger ? Je vous laisse en juger : « Un lord qui venait de manger un homard sur le pouce » (Joseph Méry, 1840), « J'ai déjeuné sous le pouce avec trois maquignons ; j'ai mangé pour ma part quatre livres d'aloyau, la moitié d'une poule d'Inde de Lisieux, un fromage de Livarot et six pommes de reinette de Caux » (Charles Jobey, 1866), « Une ample provision de viandes et volailles froides, de jambon, de fromage, d'oranges et de bon vin forment le déjeuner, exécuté, comme on dit vulgairement, sur le pouce » (Alfred Guillemin, 1867), « Il y a des estomacs délicats qui s'accommoderaient mal des copieux dîners au lard mangé sous le pouce » (Alphonse Desjardins, 1870), « Des litres, des quarts de pain, de larges triangles de Brie sur trois assiettes, s’étalaient à la file. La société mangeait sur le pouce » (Zola, 1876), à côté de « Il prendra seulement un morceau sous le pouce, on lui servira la première chose venue » (Charles Polycarpe, 1833), « Permets-moi de manger un petit morceau sous le pouce » (Ferdinand Laloue, 1843), « [Ils] mangeront un fruit, un morceau sur le pouce, peu de chose » (Champfleury, 1849), « [Il] dédaigne ce que l'on appelle le morceau sur le pouce ; il lui faut du solide » (Anne Raffenel, 1856), « Comme nos plats n'ont jamais été bien compliqués, toute place nous était bonne pour les manger sous le pouce » (Hector Malot, 1870), « Ce déjeuner spartiate [...] n'était guère qu'un morceau de pain pris sur le pouce » (Mathieu-Jules Gaufrès, 1873), « Prendrez-vous un petit morceau sur le pouce ? » (Flaubert, avant 1880), « Se contenter d'un morceau mangé sous le pouce » (Jules Beaujoint, 1888), « Il filait comme un chien à la cuisine, friand des restes du garde-manger ; déjeunait sur le pouce d'une carcasse, d'une tranche de confit froid, ou encore d'une grappe de raisin et d'une croûte frottée d'ail » (François Mauriac, 1927). Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation littérale du tour avec sur favorise l'idée d'un repas modeste (et acrobatique) : « Le déjeuner fini, pris sur le pouce − et sur le pouce de ces demoiselles vous pensez ce qu'il peut tenir » (Alphonse Daudet, 1877), « Manger sur le pouce : manger en vitesse, sans prendre le temps de se mettre à table devant une assiette. Il s'agit en général d'un repas frugal car le morceau qu'on peut mettre sur le pouce n'est pas bien gros... » (Colette Guillemard, 1990). Sans rire...
Voilà donc une expression que l'on ne sait plus par quel bout prendre : la logique plaide en faveur de sous, l'usage, en faveur de sur. « Les trois quarts de nos [...] ouvriers ne déjeunent que sur le pouce ou sous le pouce, je ne sais pas au juste », confessait Raymond Brucker en 1860 ; même hésitation sous la main d'Ernest Billaudel (1875) : « Chacun apportera son couteau de voyage et l'on mangera sur ou sous le pouce. » De fait, les auteurs ne s'accordent ni sur sa forme (même si la graphie sur le pouce est de loin la plus fréquente aujourd'hui) ni sur sa signification. Aussi ne manquera-t-on pas de mettre la main sur quelques formulations malheureuses ou ambiguës, du genre : « À dix heures la collation, prise sur le pouce [sens étendu ou figuré], le morceau de viande posé sur une tranche de pain est maintenu sous le pouce [sens propre] » (Catherine Grisel et André Niel, 1998). Est-ce une raison pour mettre ledit tour à l'index ? Faudrait pas pousser !
(1) Nombreux sont les témoignages (relevés notamment chez les chroniqueurs des usages populaires) qui vont dans le même sens : « Il donne un bon morceau de pain à son compagnon, en coupe un pour lui-même [...], ajoute au sien un morceau de volaille froide et s'assied tenant son dîner sous son pouce » (Jean-Baptiste Gouriet, 1811), « Il mangeait un morceau de poulet, debout, et le tenant sous le pouce ; un gros morceau de pain lui servait d'assiette » (Journal des débats politiques et littéraires, 1841), « Le nôtre [d'ouvrier] avait tenu à faire ce repas en plein air, et, carrément assis, jambes pendantes, le couteau en main, il rognait petit à petit un énorme croûton couronné d'une forte tranche de lard maintenue sous le pouce » (Eugène Chavette, 1869), « Lamelle de pain que l'on interpose entre le pouce et le fricot [= nourriture bon marché], lorsqu'on mange sous le pouce » (Anatole-Joseph Verrier, à l'article « tapon » de son Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou, 1908), « Toutes viandes rôties que l'on mange sous le pouce, sur un morceau de pain de froment » (La Revue du Mortainais, 1933), « Le cousin Jules serrait à pleine main une tranche de pain bis sur laquelle son pouce maintenait un cube de jambon gras » (Joseph Malègue, 1933), « [C'est] une "collation sous le pouce", ainsi nommée parce que, dédaignant assiettes et fourchettes, chaque convive maintient sous le pouce, mais séparé de celui-ci par un petit carré de pain, le morceau de chai [= viande] placé sur la tranche de pain » (Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, 1937), « Assis à l'ombre des haies, fâneurs ou laboureurs, faucheurs ou moissonneurs, devisaient en riant, un croûton à la main, la viande sous le pouce » (Gilbert Gensil, 1958), « La "deusse" est toujours accompagnée d'un morceau de lard salé cuit posé sur la tartine et tenu sous le pouce, mais le doigt est séparé du lard par une taille de pain » (Marie-Louise Heren, Folklore picard, 1966), « Vers 9 heures, on s'arrêtait pour faire une "collation sous le pouce" (cette expression vient du fait que chacun maintenait sous son pouce le morceau de viande posé sur une tranche de pain) » (Daniel Lacotte, Traditions et légendes en Normandie, 1980), « Elle se tait, le couteau au poing, une tranche de pain et un morceau de viande sous le pouce gauche » (Louis Costel, 1982), « Uniquement préoccupé à tailler, sur une épaisse tartine, un morceau de lard qu'il tenait sous le pouce » (Glenmor, 1995), « Chacun se coupa une nouvelle tranche de pain, posa dessus un gros morceau de fromage, bien calé sous le pouce » (Edmond Verlhac, 2000). D'autres mettent plutôt en avant l'action coordonnée du pouce et du couteau pour saisir les aliments : « Pas d'assiettes. Padellec coupe d'épaisses tranches de pain et, l'un après l'autre, chacun se lève pour prendre un poisson entre le pouce et le couteau » (Juliette Lartigue, 1929), « En claquant, les couteaux s'ouvrirent. Entre le pouce et la lame chacun se tailla sa part qu'il emporta sur une tranche de pain » (Yvonne Posson, conte breton, 1939), « Il ne pouvait empêcher que les rustauds ne prélèvent les mets [...], en les saisissant entre le pouce et la lame de leur couteau et qu'ils ne les écrasent ensuite sur l'épais chanteau coupé à la grosse miche du pain » (Guy Enoch, 1963). Citons encore cette variante trouvée chez Pierre-Robert Leclercq (1979) : « Il était à jamais de ceux qui tiennent leur pain sous le pouce et leur fromage sous le petit doigt, la paume tailladée comme un hachoir servant de table. »
(2) Les tours déjeuner, dîner, souper sous (ou sur) le pouce, quant à eux, sont attestés avec le premier terme employé comme verbe (à l'instar de manger) ou comme substantif (à l'instar de morceau) : « Elles déjeunèrent, comme on le dit, sous le pouce » (Nicolas-Pierre-Christophe Rogue, avant 1830), « Le déjeuner sur le pouce aura lieu sous une magnifique tente » (Balzac, 1844), « C'est joyeusement, notre déjeuner sous le pouce, que nous allâmes nous installer devant la porte » (Émile Gaboriau, 1871), « Leur dîner sous le pouce, ils vont s'appuyer à la balustrade » (Thérèse Bentzon, 1877), « Ils ont improvisé un petit souper sur le pouce » (Albéric Second, 1878), « Je soupai sur le pouce » (Georges Duhamel, 1925).
(3) Ainsi de Sylvie Claval et de Claude Duneton dans Le Bouquet des expressions imagées (1990) : « Manger sur le pouce, manger du pain accompagné de viande que l'on tranche, bouchée après bouchée, "sur le pouce". » L'argument paraît sérieux, il est surtout spécieux, car en toute rigueur la lame du couteau, quand elle viendrait buter sur le pouce, ne s'en situe pas moins sous le doigt (côté pulpe) : « Ce n'est que lorsque le morceau de viande se découpe à même le pain, sous le pouce, que l'on trouve le temps de parler » (Léon Allard, 1885), « [Des] saucisses découpées sous le pouce » (Pierre Desmesnil, 1985), « Ceci ne l'empêchait pas [...] de couper de cette même main, sous le pouce, le pain et le lard gras de son petit déjeuner » (Roger Le Taillanter, 1995), à côté de « Le lard accompagnait la soupe ; ils le taillaient sur le pouce » (Jules Vidal, 1885), « Nous savourons un bout de viande froide que l'on découpe sur le pouce avec une tranche de pain » (Les Missions catholiques, 1933).
(4) Il est à noter que le tour avec sous n'est pas inconnu du Grand Larousse du XIXe siècle (1869) : « [Il] mange son saucisson sous le pouce, tout en bûchant » (à l'article « concours »).
(5) En 1888, dans un article de la Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, Édouard Le Héricher pointa du doigt la responsabilité de l'Académie dans la confusion de l'usage : « Il y a bien des cas où nos paysans en remontreraient à l'Académie et même à ce perspicace observateur de la réalité que fut Honoré de Balzac. [...] Balzac a beaucoup puisé dans la langue du peuple, mais il semble n'avoir pas osé dire, comme lui, "manger sous le pouce", ce qui est conforme à la nature : il aura cherché dans le Dictionnaire de l'Académie et lui, si osé pourtant, a accepté "manger sur le pouce". »
(6) Citons : « Même elle est rousse Et sur son pouce Mange une gousse D'ail ou d'oignons » (Eugène Scribe, avant 1820), « Un vieux en lunettes qui découpait une charcuterie rose placée sur son pouce et la mangeait, tout en lisant son journal » (Jules Claretie, 1882), « Le père Baptiste mange sur son pouce [...]. Je le vois qui mange sur le pouce, du pain et du lard, qu'il coupe, avec son couteau de poche, en petits cubes très réguliers » (Eugène Ionesco, 1960).
(7) Témoin ces exemples : « Un repas exquis doit être savouré à table, et non dépêché sur le pouce comme fait de sa provende un vilain » (Charles de Bernard, 1838), « Je n'ai [...] que le temps de rentrer manger un morceau sous le pouce, et de courir » (Xavier Veyrat, 1841), « Les dîners sur le pouce, telle est la nouvelle institution rêvée par les nourrisseurs du genre humain. [...] On dîne à la minute, à la vapeur. Pas de table, pas de couvert, pas de garçon, mais un buffet tout dressé où vous choisissez les tranches de votre goût » (Achille Eyraud, 1855), « Ce repas sera léger et les enfants s'habituent à le faire rapidement, sur le pouce comme on dit » (Louis Chandelux, 1856), « Il mangea un morceau sous le pouce ; ce repas dura juste cinq minutes » (Paul Féval, 1863), « Nous allons expédier un petit déjeuner sur le pouce » (Albert Robida, 1883), « [À l'usine,] les aliments sont pris sur le pouce : [...] le repas du milieu de la journée dure quelques minutes, aussitôt chacun se remet à l'œuvre » (André-Émile Sayous, 1901), « C'est le repas rapide pris sur le pouce, qui n'a pas besoin d'être laborieusement digéré » (Georges Daremberg, 1905), « Après un court repas froid, avalé sur le pouce » (Maxence Van der Meersch, 1936). Force est toutefois de constater, n'en déplaise aux spécialistes de la langue, que la rapidité de l'action n'est pas toujours de mise : « Il mangeait tranquillement un morceau sur le pouce en attendant qu'on reprît la danse » (Octave Feuillet, 1850), « On soupa sur le pouce, mais de bon appétit, et si longuement que le soleil était couché quand on but le dernier coup » (Paul de Musset, 1866), « [Il] se mit à manger sur le pouce sans se presser » (Zénaïde Fleuriot, 1874), « Il avait déjeuné sur le pouce, tout en flânant le long des terrasses, d'un bout de saucisson et d'un morceau de pain » (François Coppée, 1888), « Arno tira son couteau de sa poche, coupa posément un petit cube de pain, l'assortit d'une miette de jambon et commença à mastiquer, sur le pouce, sans se presser » (Jean Raspail, 1993) ou ne va pas forcément de soi : « Ils mangeaient [...] un petit morceau sous le pouce, et à la hâte, pour perdre le moins de temps possible » (François-Victor Vignon, 1822), « Nous avons mangé un morceau sous le pouce, mais vite et mal » (Louis Énault, 1869).
(8) Qu'on en juge : « Une ample et vaste omelette mangée debout, dont chacun tiroit son morceau sous le pouce » (Roland de La Platière ?, 1777), « [Il] s'assied tenant son dîner sous son pouce » (Jean-Baptiste Gouriet, 1811), « Ces messieurs [...] se tiendront debout et mangeront sur le pouce » (Paul de Kock, 1821), « Il déjeune debout à huit heures du matin, son morceau de pâté froid sous le pouce » (Henri de Latouche, 1836), « Chacun des convives rangés debout des deux côtés de la table recevait un petit morceau de salé sur son pain, et le mangeait ainsi sans assiette, et comme l'on dit sous le pouce » (François Richard-Lenoir, 1837), « Il était dans un coin, assis sur un escabeau, mangeant, sous le pouce, un morceau de lard et du pain bis » (Saintine, 1839), « [Ils] mangèrent un morceau sur le pouce tout debout dans la rue » (Alexandre Dumas, 1844), « Je sais ce que c'est que manger sur le pouce (nous n'avions pas de chaises) » (Albert Pruvost, 1853), « Le grand Empereur s'étant assis lui-même sur le gazon [...] mangea sous le pouce avec la simplicité du soldat une tranche de jambon » (Jacques Bidot, 1860), « [Ils] mangeaient du fromage sur le pouce, assis tout le long de la vieille halle » (Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, 1864), « À l'heure du déjeuner, sur les bancs, ils mangent leur fromage sous le pouce » (Jules Claretie, 1867), « La plupart du temps on ne se met pas à table, on ne s'assied pas, et, comme on dit vulgairement, on mange sous le pouce » (Edme Jean Leclaire, 1868), « Les voilà assis devant la commode, mangeant sous le pouce » (Julie Gouraud, 1873), « [Les officiers] se résignent [...] à manger sur le pouce, l'espace ne permettant pas de dresser de table » (Casimir Pradal, 1875), « Manger sur le pouce, le coude sur la table » (Alexis Bouvier, 1877), « Prouesse mangeait sur le pouce, et ne se mettait à table que lorsqu'il allait dîner chez les autres » (Adolphe Racot, 1882), « À midi ses hommes avaient déjeuné à la hâte, sur le pouce, debout sur le trottoir ou assis sur les coussins de leur fiacre » (Xavier de Montépin, 1883), « Donnez-moi un morceau sur le pouce, je mangerai sur le coin de la table de cuisine » (Hugo, 1887), « On s'assied alors devant le feu qui déjà s'éteint et le pique-nique est attaqué avec un appétit robuste [...]. On mange sous le pouce » (Jules Lecoeur, 1887).
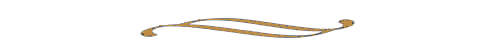
Remarque 1 : Employé comme locution adverbiale au sens de « à la hâte, rapidement », le tour sur le pouce s'est construit avec d'autres verbes que manger, déjeuner... : « On y mange comme on y vit... sur le pouce » (Albéric Second, 1844), « Entamons là, sur le pouce, un petit dialogue de circonstance » (Albéric Second, 1855), « Il dormait comme mangent les gens pressés, sur le pouce » (Alexandre Dumas, 1857), « Ce livre écrit au courant de la plume et "sur le pouce" si l'on veut bien nous passer cette expression » (Oscar Comettant, 1865), « La question n'est pas de celles qui se traitent sur le pouce » (George Japy, 1877), « Je me mis à parler sur le pouce, comme ça, de la campagne de 1816 » (Céline, 1932). Cet emploi est qualifié de « vieilli » par le TLFi.Remarque 2 : On notera avec intérêt que l'équivalent anglais de notre locution est under the thumb (« sous le pouce ») : « [Food] was eaten "under the thumb", so called because the men held it and cut off pieces with a "shut" knife » (Sarah Butler, 1975).

Livre de Marie-Laure André 1 commentaire
1 commentaire
-

« Si elle avait eu une voix, elle se serait écrié : Tire-moi dessus ! »
(William Olivier Desmond, traduisant le roman de Stephen King Cœurs perdus en Atlantide, paru chez Albin Michel)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en penseÀ en croire les spécialistes de la langue, le participe passé du verbe s'écrier s'accorde toujours avec son sujet : « Ils se sont écriés qu'on les trompait » (Hanse), « Elles se sont écriées » (Girodet), « Elles se sont écriées que... » (Bescherelle), « Elles se sont écriées : "Jamais !" » (Josette Rey-Debove), « Plusieurs journalistes se sont écriés avec indignation dans leur quotidien » (Robert), « Ils se sont écriés : Tant mieux ! » (Larousse). La raison en est fort simple : s'écrier, lit-on à l'article « pronominal » de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, est un verbe essentiellement pronominal, c'est-à-dire qu'il n'existe « que sous cette forme à la différence des verbes pronominaux formés à partir de verbes transitifs ».
À y regarder de près, l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. D'abord, parce que l'argument avancé est historiquement faux. N'en déplaise aux académiciens (et à la plupart des grammairiens), s'écrier n'est pas à proprement parler un verbe essentiellement pronominal, mais plutôt un verbe qui est devenu uniquement pronominal. C'est qu'il ne faudrait pas oublier (comme le fait pourtant le Dictionnaire historique de la langue française) que le bougre existait également sous une forme simple en ancien français : le verbe escrider, apparu au Xe siècle, puis escrier, lequel a longtemps admis diverses constructions non pronominales. À côté de celles propres au discours rapporté li escrie que (+ discours indirect lié) et li escrie (+ discours direct), attestées au XIIe siècle chez Chrétien de Troye, on relève notamment des emplois transitifs, au sens de « prononcer en criant ; proclamer » (avec pour objet direct la chose criée) et de « appeler à grands cris ; informer, avertir ; décrier » (avec pour objet direct la personne visée) : « Franceis [il] escri(d)et, Oliver [il] apelat » (Chanson de Roland, 1080), « Escri(d)ent l'enseigne [= cri de reconnaissance], escri(d)ent un sermon [= discours] » (Ibid.), « Et chascun escrioit son non » (Marie de France, XIIe siècle), « Puis [il] escrie sa gent » (Jean Bodel, XIIe siècle), « Adont li escria un mot plain de plaisance » (Florence de Rome, XIIIe siècle), « Il li escrie trois mos per reprover » (Les Enfances Guillaume, XIIIe siècle), « Quand il les vit, il les escria » (Jean de Joinville, XIIIe siècle), et encore au XVe et au XVIe siècle : « Chascun sire escria son cri » (Jean Froissart, avant 1410), « Mesmement fut tant la chose escriée que [...] » (Les Cent nouvelles nouvelles, vers 1460), « Il escrie sez ennemis : "A mort, a mort !" » (Le Livre d'Alixandre, XVe siècle), « Le survenant par tels mots il escrie » (Joachim du Bellay, 1552), « Ha ha, madame de Pimprenelle (ce m'escria ceste furieuse et arrogante deesse de ce monde) » (Calvy de La Fontaine, 1556), « Escrier ces mots en effect et substance » (Jean de Visch, 1567), « L'occasion est-elle juste de escrier son nom et sa puissance [de Dieu] ? » (Montaigne, 1580), « Que peut elle dire et escrier autre chose, sinon qu'elle ne soit aymee ? » (Gabriel Chappuys, 1587). Rien que de très logique, au demeurant, dans la mesure où escrier, écrier n'est autre que crier auquel a été ajouté le préfixe es-, é- (latin ex-), qui marque « la sortie, ici l’explosion du cri » (selon la revue pédagogique L'Abeille, 1857), « l'idée d'altération de l'état physique ou émotionnel » (selon Michel Aunargue et Marc Plénat, dans leurs Carnets de grammaire, 2007).
Ensuite, parce que son corollaire « Dans s'écrier, le pronom réfléchi n'est ni objet direct ni objet indirect ; il n'a pas de fonction grammaticale et ne peut s'analyser » ne va pas de soi. Si l'on a pu dire jadis écrier quelque chose à quelqu'un, avec le sens de « dire d'une voix forte (subitement et sous le coup d'une émotion) quelque chose à quelqu'un », n'est-on pas fondé à admettre aujourd'hui s'écrier quelque chose, avec se mis pour « à soi-même, pour soi-même » ? C'est ce qu'affirment, contre l'avis général, Jacques Damourette et Édouard Pichon dans Des Mots à la pensée (1936) : « L'histoire, on le voit, confirme que s'écrier est un réfléchi assomptival [comprenez : le pronom se y a valeur de complément d'objet indirect] et que l'on n'a commencé à écrire "Louise s'est écriée", "Louise et Charles se sont écriés", etc., qu'au moment où l'on a perdu la compréhension nette de la construction. [...] Et même, on pourrait, semble-t-il, très bien dire : "Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais il s'est écrié quelque chose." » Les arguments contraires ne manquent pourtant pas : qui ne verrait que l'association de l'objet indirect « à soi-même, pour soi-même » avec un verbe de parole indiquant une voix forte et tournée vers autrui est contre nature (1) ? et comment expliquer l'apparition (au XVIe siècle) de la construction s'écrier à quelqu'un (2) ? Pour Anna Granville Hatcher (The rise and fall of s'écrier in French, 1940), le pronom se fait bien plutôt office d'objet direct : selon cette linguiste américaine, s'écrier signifiait proprement, à l'origine, « écrier soi-même » au sens de « écrier sa propre voix », l'accent étant mis non pas sur la personne interpellée ni sur les paroles rapportées mais sur l'acte vocal lui-même, sur le fait de pousser des cris. Elle n'en veut pour preuve que l'ancienne construction avoir sa voiz escriée (3) qui serait, toujours selon elle, la racine « conceptuelle » du tour moderne s'écrier. Voire. Car alors, comment justifier cette fois l'emploi de s'écrier avec un nom (ou un pronom) pour complément d'objet direct, attesté depuis la fin du XIe siècle : « E [il] s'escri(d)et l'enseigne » (Chanson de Roland, 1080), « A sa vois clere c’est escrié III mos [= trois mots] : "Ou iés [...] ?" » (Raoul de Cambrai, XIIe siècle), « D'amours c'escriait trois mos » (anonyme, XIIe siècle), « Ce qu'il s'est escrié monstre la grande véhémence » (Jean Calvin, 1555) ? Mais poursuivons notre tour d'horizon. À en croire Léon Clédat (Revue de philologie, 1907), c'est une tendance ancienne de la langue que de former des verbes pronominaux à partir d'intransitifs précédés de l'adverbe en (en aller, en fuir, en voler...) ou du préfixe es-, é- (écrier, écrouler) pour indiquer le commencement de l'action : « L'adverbe en (joint à des verbes de mouvement) et le préfixe é marquent le point de départ de l’action, et le pronom réfléchi, qui est une sorte de complément circonstanciel équivalant approximativement à "par soi", peut être considéré comme exprimant une idée qui s’accorde bien avec celle de point de départ : la mise en train de l’action par le sujet. [...] On peut donc interpréter il s’écrie par : il se met à crier ». Enfin, selon Jean Stefanini (La Voix pronominale en ancien et en moyen français, 1962), rares sont, dans l'ancienne langue, les verbes pronominaux qui se construisent avec un objet direct ; parmi eux se trouvent surtout des verbes de déclaration et d’opinion : soi dire, soi escrier, soi penser... (mais aussi soi avoir, soi vouloir, soi tenir), « où le pronom réfléchi, si l'on veut le classer dans les cadres traditionnels, apparaît comme un datif éthique, et non comme un complément d’attribution » − autrement dit, soi escrier ne signifiait pas « escrier à soi, pour soi », mais simplement « escrier »... avec une nuance particulière de sens, le pronom réfléchi indiquant « le caractère "intérieur", psychique du procès et non le bénéficiaire de l’action » (4). Un complément d'objet indirect, un complément d'objet direct, un complément circonstanciel ou un datif éthique : ce doit être ce que l'on appelle l'embarras du choix !
On m'objectera à grands cris que ces considérations datent d'un autre âge, que cela fait belle lurette que le verbe écrier ne s'écrit plus qu'avec le pronom personnel, que l'usage et les grammairiens ont désormais choisi leur camp. Ainsi Gustave Guillaume affirme-t-il de façon péremptoire qu'« il est impossible de donner à s’écrier un objet direct d’aucune espèce » (Leçon de linguistique du 21 mars 1946) ; selon Marc Hug, s'écrier, contrairement à crier ou à dire (5), « n'admet pas de complément tel que cela, quelque chose ou Déterminant + Nom. Il tend, en français actuel, à se spécialiser dans le rôle d’introducteur de paroles rapportées, généralement en style direct » (Structures du syntagme nominal français, 1989) ; « dans le cas de s'écrier : "P" (ou s'écrier que P), confirme Pierre Le Goffic, le véritable complément direct est le réflexif [se], comme en témoigne l'accord (Elle s'est écriée que P). La complétive, d'apparence directe, [est] non pronominalisable et sans commutation avec un groupe nominal » (Grammaire de la phrase française, 1994). De là la position du Bon Usage : « Quand s'écrier, se récrier, s'exclamer servent à présenter un discours rapporté, celui-ci ne joue pas le rôle d'un véritable objet direct − même le discours indirect lié n'est pas senti comme un véritable objet direct (on pourrait parler de pseudo-objets-directs) −, et le participe passé de ces verbes s'accorde avec le sujet : Mme Verdurin s'était écriée : "Je vous crois un peu qu'elle est belle ! (Proust). Certains se sont écriés que c'était un scandale (Dictionnaire contemporain). Tu t'ennuierais ! s'est exclamée la tante (Hervé Bazin). » « Des pseudo-objets-directs ? » m'écrié-je à mon tour. Il ne manquait plus que ça... À la vérité, on s'étonne surtout qu'un Grevisse, d'ordinaire si prompt à répertorier les diversités de notre langue, ait ignoré de la sorte et la construction directe avec un nom de chose − toujours vivante contrairement à celle avec un nom de personne −, et les cas de commutation avec un pronom (exceptionnels, il est vrai) ou avec un infinitif (plus fréquents), et les exemples − au demeurant pas si rares − de l'invariabilité que Damourette et Pichon appelaient de leurs vœux dans les contextes de discours rapporté (6). Jugez-en plutôt :
(s'écrier + nom ou pronom COD) « Voyons ce qu'elle s'écria » (Arthur de Gobineau, 1847), « [Il] allait s'écrier [...] le sacramental : Disparaissez ! » (Villiers de L'Isle-Adam, 1888), « Comme l'auteur se l'est écrié [...] : "Retournons aux ruines" » (La Jeune Belgique, 1896), « Et le stathouder de s'écrier cette phrase [...] » (Richard O'Monroy, 1898), « Mais il ne s'écria rien du tout » (Henry Desnar, 1900), « Savez-vous ce qu'il s'écria ? » (Henri Joly, 1902), « Elle sera sourde, disait l'une, aveugle, opinait l'autre, et toutes de s'écrier ceci, qui paraît véritablement exorbitant : Elle sera muette » (Journal officiel de la Société des Nations, 1925), « Puis il s'écria quelque chose de tout à fait extraordinaire » (Pierre Frondaie, 1934), « Il s'écriait ces mots qu'on vient de répéter » (René Spaeth, président de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Alsace, 1970), « Si un homme [...] s'écrie quelque chose comme : "Ce n'est vraiment pas juste" » (Yves Lelong, 1987) (7) ;
(s'écrier + infinitif COD) « Boutard s'est écrié avoir été blessé par Jaubertière » (Denis Talon, XVIIe siècle), « [Elle] s'écria avoir vu une âme entre deux tonneaux » (Saint-Edme, 1824), « Il s'est écrié avoir hâte d'informer le ministre » (MM. Defranoux et Lervat, 1864), « Si, en voyant passer un païen, on s'écrie avoir entendu exprimer par ce païen [...] » (Moïse Schwab, 1871), « Elle s'écrie avoir la pépie au bout des doigts » (Jean Lorrain, 1896), « [Elle] s'écrie avoir vu le livre » (Camille Flammarion, 1907), « Il s'écrie avoir exécuté ses compositions épiques » (Charles Dédéyan, 1946), « [Il] s'écrie avoir rencontré "de faux curés" » (Jacques Prévotat, 1998), « Mon ami s'était écrié avoir été menotté » (Frédéric-William Girma, 2017), « Après que le jeune garçon s’est écrié avoir découvert une grotte préhistorique » (Français - Livret de l'enseignant) ;
(invariabilité du participe passé) « Les uns se sont écrié : quelle folie ! » (Mirabeau, 1777), « Elle s'est écrié : "J'aime mieux mourir [...] » (Henriette Campan, 1803), « Nos camarades se sont écrié(s) : "Vous l'entendez !" » (Eugène Scribe, selon les éditions), « Elle s'est écrié(e) en sanglotant : "Hélas !" » (Eugène Sue, selon les éditions), « Quelle douceur ! se fussent écrié Bélise et Philaminte » (Gaspard de Cherville, 1889), « Les officiers [...] s'étaient écrié que tout était fini » (Pierre de La Gorce, 1904), « Les Anglais se sont écrié : "We shall have them !" » (Émile Hinzelin, 1916), « "Nous régnons trop jeunes", s'étaient-ils écrié tous deux » (Henri-Robert, 1928), « Comment, s'étaient-elles écrié dans un émoi spontané, vous partez ? » (Henry Bordeaux, 1937), « Elle s'était écrié : "Et si nous avions un enfant ?" » (Célia Bertin, 1949), « "Courage ! [...]" s'étaient écrié Fama et le griot Diamourou » (Ahmadou Kourouma, 1968), « Des ouvriers se sont écrié : On demande [...] » (Pierre Pascal, 1977), « Elle s'était écrié : "C'est absolument impossible !" » (Françoise d'Eaubonne, 1994), « Là, s'est-elle écrié » (Madeleine Chapsal, 1999), « Les voleurs s'étaient écrié : "Taisez-vous !" » (Sophie Valle, Dictées La Compil' : cahier d'entraînement à l'orthographe, 2015) (8).
Et que penser encore de cette consigne trouvée dans Tout le français - Concours orthophoniste (2014) de Benoît Priet : « Certains pronominaux subjectifs [dont le pronom conjoint n'est pas analysable] peuvent avoir des COD et donc suivre la règle d'accord [générale] : s'écrier, se récrier, s'exclamer. Ex. : Sa sœur s'est exclamée : "Qui prendra ma défense ?" / Sa sœur s'est exclamé que personne ne prendrait sa défense. Explication : Dans le premier exemple, la question au discours direct est séparée du début de la phrase par une ponctuation, elle n'est pas COD du verbe s'exclamer et on accorde donc avec le sujet sœur ; dans le second exemple, que personne ne prendrait sa défense est COD postposé de s'exclamer, donc on n'accorde pas » (9) ? Tout bien compté, nous voilà avec trois analyses différentes (la première étant de loin la plus courante) :
- Elle s'est écriée : "La vie est belle !" / Elle s'est écriée que la vie était belle (accord systématique avec le sujet, selon la plupart des spécialistes),
- Elle s'est écrié : "La vie est belle !" / Elle s'est écrié que la vie était belle (invariabilité, selon Damourette et Pichon),
- Elle s'est écriée : "La vie est belle !" / Elle s'est écrié que la vie était belle (accord avec le sujet dans le discours direct, invariabilité dans le discours indirect lié, selon Benoît Priet).
Allez réconcilier les Français avec l'accord du participe passé des verbes pronominaux, après ça !
(1) On trouve toutefois : « Il s'escria en soi-mesme, Ô Seigneur Dieu [...] » (Jean Crespin, 1619), « Et s'écrier à soi-même avec une profonde admiration : Ô humilité sans pareille ! » (Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des religieuses ursulines, 1807).
(2) « Et se escria a ses freres » (L'Histoire du preux Meuruin, 1540) ; « S'escrier à tout le monde que [...] » (Martin du Bellay, 1541) ; « Ô Seigneur, à toy je m'escrie » (Théodore de Bèze, 1562) ; « Il s'escria à ceux qui estoient à l'entour de luy » (Jacques Amyot, 1567) ; « Si je m'escrie à vous » (Guillaume du Vair, 1591) ; « Elle s'escria à eux : Señores [...] », « Monsieur de Bussy s'escria à Monsieur Strozze » (Brantôme, avant 1614), « Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put » (La Fontaine, 1668).
(3) « [Il] a sa voiz escriée : "Baron François [...]" » (Guillaume d'Orange, XIIe siècle), « Molt hautement [il] a sa voiz escriée : "Que fetes ci [...] ?" » (La Mort Aymeri de Narbonne, XIIIe siècle).
(4) Dans son Essai de grammaire générale (1837), Pierre-Joseph Proudhon parle quant à lui de « verbe de spontanéité », qui « exprime un sentiment spontané », dont l'action se réalise indépendamment de la volonté. Crier aurait ainsi pour correspondant de spontanéité s'écrier, sans qu'il soit possible « en bonne logique de regarder le pronom comme régi par le verbe ».
(5) Grevisse précise que les verbes transitifs crier, dire, déclarer, demander, penser, préciser, répliquer, rétorquer, etc. « ont leur besoin d'objet direct satisfait par la présence, soit du discours indirect lié qui est un véritable objet direct, soit du discours direct qui est un équivalent non syntaxique, parataxique de cet objet ».
(6) « Il serait à souhaiter que la grammaire normative adoptât la graphie "Louise s'est écrié", "Louise et Charles se sont écrié", [...] historiquement attendue et normativement recommandable. »
(7) Et aussi : « Il s'écria ces mots : Il est avantageux [...] » (Hippolyte Caplain, « instituteur, auteur de plusieurs ouvrages classiques », 1837), « Il s'écria des paroles entrecoupées de sanglots » (A.-B. Ozun, « professeur de français, latin, belles-lettres », 1849), « Un cardinal s'écria ces paroles connues : "Le voilà !" » (Antoine Madrolle, 1851), « On sait ce qu'il s'écria en montant sur l'échafaud » (Charles de Larivière, 1902), « Pierné s'écrie... Je ne peux pas dire ce qu'il s'écrie, Messieurs » (Henri Bréal, 1914), « C'est alors que je m'écriai ce que vous savez » (Pierre Héricourt, 1925), « Il se vexa et s'écria ce qui suit : "Toujours ce Wirsich !" » (Walter Weideli, 1970), « Il ne s'écria rien de semblable » (Gil Lacq, 1994).
(8) Et aussi : « Elle s'est écrié ensuite que [...] » (Pierre-François Guyot Desfontaines, 1735), « Elle s'est écrié : ah, cela me pénetre ! » (Marie-Jeanne Riccoboni, 1773), « "Où sont-ils ? s'étaient écrié tous les Francs » (François Vernes, 1790), « Il le sera par moi, s'est-elle écrié d'un ton terrible » (Pigault-Lebrun, 1815), « Elles se sont écrié éplorées : "Ô sort ! [...]" » (Alfio Grassi, 1825), « Elles s'étaient écrié : "Si le mal continue [...]" » (Charles Gueullette, 1862), « Pour un peu, elle se fût écrié : "Je peux jurer que [...] » (Jules Lermina, 1885), « Elle s'est écrié : "Dites à [...]" » (Émile Richebourg, 1886), « Ils se sont écrié avec l'accent d'une douce confiance : O pia » (Charles-Benjamin Poisson, 1890), « Quelques forcenés [...] s'étaient écrié : "Pas de Dieu !" » (Gustave Dupont-Ferrier, 1922), « Fureur des chefs [...] qui se seraient écrié : "Ces monstres [...]" » (Émile Gabory, 1933), « Ils se sont récrié que cela n'avait rien à voir » (Georges Dovime, 1935), « Elles s'étaient écrié en chœur : "Détruisons la famille" » (Le Sexisme ordinaire, collectif, 1979), « Hutin et Doisnel se sont récrié en même temps : "Croyez bien que [...] » (Pierre-Jean Remy, 1985).
(9) On lit de même dans La Structure des phrases simples en français (Jean-Paul Boons, Alain Guillet, Christian Leclère) : « Verbes dénotant un acte de parole (s'écrier, se récrier, s'esclaffer, s'exclamer, se lamenter) ; ils acceptent tous un objet direct Que P. »
Remarque 1 : La confusion est telle que des ouvrages, qui paraissent dignes de confiance, en viennent à préconiser de remplacer, dans le passage du discours direct au discours indirect, s'écrier par dire, demander, répondre... « afin de respecter la construction syntaxique (le verbe s'écrier, pronominal, n'accepte pas de COD) » (Objectif concours de recrutement des professeurs des écoles - Annales français, 2018). L'Académie, qui ne voit rien à redire à « Je m'écriai que c'était injuste » (neuvième édition de son Dictionnaire), appréciera...
Remarque 2 : Selon Jean-Paul Jauneau, « la proposition subordonnée interrogative est une proposition complétive lorsqu'elle est construite indirectement, c'est-à-dire lorsqu'elle complète un verbe déclaratif annonçant une question, comme crier, dire, demander (se), [...], s'écrier, etc. » L'auteur de N'écris pas comme tu chattes (2011) avait-il à l'esprit cette phrase de Pierre Danet : « Il s'écria pourquoy ils venoient à luy » (Magnum Dictionarium latinum et gallicum, 1691) ? On eût apprécié un exemple... récent.
Remarque 3 : On notera que le verbe s'écrier double le i aux deux premières personnes du pluriel de l'imparfait de l'indicatif et du présent du subjonctif : (que) nous nous écriions, (que) vous vous écriiez.

Ce qu'il conviendrait de dire
Elle se serait écriée (selon la plupart des spécialistes). votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Richesse et difficultés de la langue française

