-
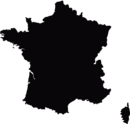
« Depuis François Ier, la France est par ailleurs en bon terme avec les Turcs pour contrer les Habsbourg. »
(Sibylle Chevrier, sur bvoltaire.fr, le 6 octobre 2017)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Sans doute est-il utile de rappeler ici − histoire de mettre un terme à toute hésitation − que celui-ci s'écrit au pluriel dans l'expression être en bons (ou en mauvais) termes avec quelqu'un, laquelle signifie « entretenir de bonnes (ou de mauvaises) relations avec lui » : « On creut qu'ils estoient demeurez en bons termes » (Nicolas Coeffeteau, 1623), « Ils étoient en très mauvais termes avec leur prince » (Richelieu, vers 1640), « Il [...] est en bons termes avec tout le monde » (Prosper Mérimée), « Il me paraissait à peu près impossible de me maintenir longtemps en bons termes avec [elle] » (Anatole France), « Il était dans les meilleurs termes avec Mme R., la doctoresse » (André Gide), « Non que les deux hommes fussent en mauvais termes » (André Maurois), et aussi « En quels termes était-il avec elles ? » (Georges Simenon), « Vous êtes toujours dans les mêmes termes avec votre femme ? » (Boris Vian). N'allez pas croire pour autant, comme le donne à penser la maison Larousse, que l'on en vienne dans ces cas à dire nécessairement du bien (ou du mal) d'autrui (1), à l'instar de l'expression voisine parler en bons (ou en mauvais) termes de quelqu'un. Non ! Il n'est que de consulter les dictionnaires historiques pour s'aviser que le pluriel termes, dans ces deux locutions, doit être pris avec des acceptions différentes.Emprunté du latin terminus (« borne, limite »), terme s'est d'abord employé au sens de « date à venir ; délai, échéance » (XIe siècle). De l'idée de limite temporelle (à court terme, le terme de la vie), on est passé à celles de limite spatiale (hors des termes de ladite terre, les termes royaux) et d'aboutissement (mettre quelque chose en terme). De là le pluriel termes s'est dit de l'état, de la situation où l'on aboutit : « Et comme Gadiffer estoit en ces termes » (Roman de Perceforest, vers 1340 ?), « Et le sçavoit-on bien à Hesdin en quels termes il en estoit » (Georges Chastelain, vers 1465), « En très dolens et piteux termes » (Vigiles de Charles VII, vers 1484) et aussi − par le truchement du sens figuré de « limite imposée (dans les relations avec autrui) » − de la manière de se conduire, de se comporter, notamment dans l'expression tenir bons termes à quelqu'un, qui a signifié « être en règle, être en bonnes relations avec lui » (2) : « [Il] tint si bons termes et sy bonnes manieres envers ceulx de Pampelune » (Roman de Guillaume d'Orange, XIIIe siècle), « Je loue bien [= recommande] à un Prince de tenir bons termes aux marchans » (Philippe de Commynes, 1498). De la rencontre de ces deux acceptions est vraisemblablement issu le sens qui nous intéresse ici et que le Dictionnaire (1718-1878) de l'Académie définit en ces termes : « État où est une affaire, position où est une personne à l'égard d'une autre, par rapport à une affaire. En quels termes est cette affaire ? Elle est en bons termes, en mauvais termes. L'affaire d'un tel est en termes d'accommodement. Les parties sont en termes de conclure à l'amiable. Ce mariage est en termes de se conclure, de se renouer. En quels termes êtes-vous avec lui depuis votre querelle ? » Parallèlement à ces emplois s'est développé, à partir du milieu du XIVe siècle, le sens de « mot, expression d'une idée par le langage » − « parce qu'[un terme] circonscrit l'idée et lui donne des limites », lit-on dans le Dictionnaire étymologique (1863) de Paul-Adolphe Mazure −, auquel est rattachée l'expression parler en bons (ou en mauvais) termes de quelqu'un.
Toujours est-il que termes, dans parler en bons (ou en mauvais) termes de quelqu'un − où il s'agit clairement d'user de mots − comme dans être en bons (ou en mauvais) termes avec quelqu'un − où il est bien plutôt question de la nature des relations avec autrui −, s'écrit au pluriel. Et c'est là ce que l'on retiendra au terme de cette chronique.
(1) Encore qu'il soit rare, je vous l'accorde, d'être amené à dire du mal (du bien) de la personne avec qui on est censé être en bons (en mauvais) termes...
(2) Lesdits termes se voyaient qualifier de rigoureux dès lors qu'il s'agissait de témoigner son mécontentement : « Lequel pourroit luy en tenir quelques rigoureux termes » (Martin du Bellay, avant 1559).

Ce qu'il conviendrait de dire
La France est en bons termes avec les Turcs. votre commentaire
votre commentaire
-

« Enfant, mes parents m’autorisaient de tout lire. »
(Michel-Édouard Leclerc, sur son blog, le 14 octobre 2017)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Bel exemple d'anacoluthe (1), s'il en est ! Mais là n'est pas l'objet de ce billet. Intéressons-nous plutôt au verbe autoriser. J'en étais resté, pour ma part, à un transitif direct pouvant se construire avec un infinitif complément introduit par à (2) : autoriser quelqu'un à faire quelque chose (« lui en donner la permission, le pouvoir ou le droit ») et non pas autoriser quelqu'un de faire quelque chose (ni autoriser à quelqu'un de faire quelque chose, sous l'influence des verbes permettre, interdire). Je n'en veux pour preuve que ces exemples puisés aux sources les plus autorisées : « À ne vous rien cacher son amour m'autorise » (Pierre Corneille), « Mes torts ne vous autorisent point à violer vos promesses » (Jean-Jacques Rousseau), « Auguste n'était pas autorisé à la traiter en maître » (Émile Zola), « Orphée fut autorisé à aller chercher sa morte ressuscitée » (Jules Supervielle), « Elle avait demandé à son père de lui donner sa dot et de l'autoriser à vivre à Paris » (André Maurois), « Je vous autorise à venir me faire une scène ici » (Jules Romains), « Rien ne vous autorisait à le tuer » (Marcel Aymé), « Je ne vois vraiment pas ce qui dans mon attitude a pu vous autoriser à me traiter de coquebin » (Jean Anouilh), « Votre mère m'autorise à prélever sur sa dot les sommes nécessaires au rachat du cheptel » (Hervé Bazin).Sans doute m'objectera-t-on, à la décharge du contrevenant, que autoriser (quelqu'un) de est attesté dans l'ancienne langue à côté de autoriser à : (suivi d'un nom) « [Il] authorisa le prince d'Hespaigne son fils de la surintendance de son conseil » (Vincent Carloix, XVIe siècle), « Le larron, du pillage estant authorisé, repille effrontément sans crainte du supplice » (Pierre de Brach, XVIe siècle) ; (suivi d'un infinitif, surtout dans la langue administrative ou juridique) « Quelque passage de Bulle ou d'acte légitime d'Archevêque, qui les autorise de faire des Visites » (Défense de l'exemption et de la jurisdiction de l'abbaye de Fescamp, 1689), « Les demandes et doléances que Sa Majesté les autorise de faire dans l'assemblée qui doit se tenir » (Cahiers de doléances, 1789), « [Un décret] les autorise de faire acheter chez les particuliers » (Archives parlementaires, 1793). Mais ça, c'était avant ! De nos jours, mieux vaut ne pas s'autoriser trop de libertés si l'on veut éviter de verser dans l'archaïsme... voire carrément dans le solécisme, à en croire André Moufflet : « En vertu de la règle [selon laquelle de indique l'origine, quand à indique la destination et se rapporte à l'avenir] on condamnera la tournure suivante : Je ne puis vous autoriser de prendre actuellement une permission de trente jours » (Contre le massacre de la langue française, 1931). Un usager averti en vaut... de(ux) !
(1) Vous m'autoriserez à rappeler ici qu'une anacoluthe − du grec anakolouthos (« qui n'est pas à la suite de, qui n'est pas conséquent avec ») − est une rupture dans la construction syntaxique d'une phrase. En l'espèce, le nom apposé enfant ne renvoie pas au sujet mes parents, comme le voudrait une grammaire stricte, mais au complément d'objet m'.
(2) Il y a hésitation sur la fonction grammaticale dudit infinitif : complément d'objet direct (COD) ? complément d'objet indirect (COI) ? complément circonstanciel de but (CCB) ? Jean-Paul Jauneau se contredit lui-même entre les deux tomes de son livre N'écris pas comme tu chattes : « On dit autoriser quelqu'un (COD) à faire quelque chose (CCB) » (Tome 1), mais « C'est toute la proposition, formée par le nom ou le pronom sujet et par l'infinitif lui-même, qui est COD. Je vous autorise à sortir (= j'autorise que vous sortiez) » (Tome 2), sous le prétexte que « la question posée après le verbe est quoi ? et non à quoi ? » et que la transformation à la voix passive donne « Sortir vous est autorisé » sans recourir à à (que les grammairiens qualifient dans ce cas d'introducteur d'infinitif, de subordonnant ou de préposition vide). Seulement voilà, si c'est l'ensemble sujet de l'infinitif + infinitif + compléments éventuels de l'infinitif qui forme une subordonnée infinitive COD, comment expliquer l'accord « Le médecin a autorisé Marie à sortir. Il l'a autorisée à sortir » préconisé par Bescherelle ?
Remarque : Le tour autoriser quelque chose à quelqu'un, bien que déconseillé par Hanse, se trouve sous quelques bonnes plumes : « Heureusement il y avait les parties de foot sur la plage, les osselets de Virgilio et le cinéma le dimanche après-midi lorsque les aînés nous l'autorisaient » (Joseph Joffo), « Elle [une statue] boit le spectacle que lui autorise son œillère jusqu'à la lie de la perpétuité » (Yann Moix), « [Il] lui autorise l'accès aux toilettes du chantier » (Virginie Despentes). L'Académie a beau feindre de l'ignorer dans la dernière édition de son Dictionnaire − sans doute lui préfère-t-elle permettre quelque chose à quelqu'un ou autoriser quelque chose (sans COI) −, elle accueille sans barguigner la construction pronominale associée s'autoriser quelque chose. Comprenne qui pourra !
Rappelons à ce sujet que le pronominal s'autoriser se construit avec de + nom au sens de « prendre prétexte de, s'appuyer sur, se prévaloir de », avec à + infinitif au sens de « se donner le droit, la permission de » ou directement avec un nom au sens de « s'accorder (quelque chose) » : « Il s'autorise de votre exemple pour agir ainsi. Il justifiait leur conduite pour s'autoriser à les imiter. De temps à autre il s'autorise une plaisanterie. Il ne s'autorise aucun répit » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie) − on a aussi dit autrefois : Il s'autorise roi (au sens de « s'attribuer le pouvoir royal ») et Les coutumes s'autorisent par le temps (au sens de « acquérir de l'autorité »). C'est donc à tort, me semble-t-il, que Jean-Paul Jauneau laisse planer un doute dans son ouvrage déjà cité : « En ce qui concerne un verbe comme s'autoriser à, on peut se demander si le pronom réfléchi est COD (on autorise soi-même à faire quelque chose) ou COI (on autorise à soi-même de faire quelque chose). » Seule la première analyse est recevable.
Attention à l'accord du participe passé : Ils se sont autorisés de vos arguments pour le critiquer. Elle s'est autorisée à le critiquer. Elles se sont autorisé une critique. La critique qu'elles se sont autorisée.
Ce qu'il conviendrait de dire
Quand j'étais enfant, mes parents m’autorisaient à tout lire. 6 commentaires
6 commentaires
-

« Panzani élabore ses recettes de sauces avec des tomates de plein champs, mûries au soleil. »
(sur panzani.fr)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Loin de moi l'intention d'en faire tout un plat (en sauce), mais c'est vraisemblablement sous l'influence de temps que champ se voit plus souvent qu'à son tour affubler d'un s au singulier. Rappelons à toutes faims, pardon à toutes fins utiles que celui-ci est emprunté du latin campus (« plaine », d'où « plaine cultivée, champs », « champ de bataille » et au figuré « champ d'action »), nom masculin de la deuxième déclinaison qui fait campum à l'accusatif, alors que celui-là est issu de tempus, nom neutre de la troisième déclinaison qui ne change pas de terminaison à l'accusatif. Or, ce sont précisément les formes à l'accusatif qui se sont maintenues le plus souvent en français. Ainsi temps a-t-il conservé le s étymologique que champ a perdu. Il convient donc d'écrire de plein champ, comme le confirme l'Académie à l'entrée « culture » de la neuvième édition de son Dictionnaire : « Culture de pleine terre, de plein champ. »Le pluriel de pleins champs (avec un s à pleins et à champs) serait-il pour autant incorrect ? Après tout, on trouve bien les graphies en plein champ et en pleins champs sous la plume de nos écrivains. J'en veux pour preuve cette moisson de citations : « Savez-vous pour la gloire oublier le repos, / Et dormir en plein champ le harnais sur le dos ? » (Boileau), « Je me mis en devoir de sortir mes effets, déterminé à les laisser en plein champ » (Rousseau), « Elle accoucha en plein champ par un matin de printemps » (Maupassant), « L'idée qu'il pût un jour manger à la gamelle et coucher en plein champ lui faisait dresser les cheveux sur la tête » (Sand), « Nous avons vu en plein champ un chaland qui arborait un mât et des voiles » (Giono), « La gare était située en plein champ » (Obaldia), « Le convoi s'était arrêté trente fois ou davantage en plein champ » (Dutourd), à côté de « Un exercice modéré en pleins champs » (Lamartine), « Comme un manouvrier en pleins champs » (Baudelaire), « Cela lui semblait naturel d'être en pleins champs » (Zola), « Nous finîmes par coucher tous en pleins champs » (Gide), « On se retrouvait en pleins champs, on entendait des cloches lointaines » (Proust), « C'était ici, à cette halte en pleins champs » (Green) (1). Pourquoi n'aurait-on pas également le choix du nombre avec de plein champ ?
Commençons par observer que l'Académie n'a jamais écrit en plein champ autrement qu'au singulier dans son Dictionnaire. Pour autant, on peut lire à l'entrée « champ » de la dernière livraison dudit ouvrage : « Par extension. Surtout au pluriel. L'ensemble des terres, labourées ou non, situées hors des agglomérations. [...] Expression. En plein champ, en pleine campagne [2]. À travers champs, sans suivre les sentiers. » Consigner une locution au singulier parmi des emplois « surtout au pluriel », avouez qu'il y a de quoi semer le trouble... et récolter la contestation : « On dit en plein champ (selon l'Académie), et mieux peut-être en pleins champs (avec le signe du pluriel), pour dire au milieu de la campagne, loin de toute habitation et à ciel découvert » (Dictionnaire de la conversation et de la lecture, 1834). Meilleur, le pluriel ? C'est que la langue classique, nous apprend le Grand Larousse, avait pris l'habitude d'employer le mot champ au pluriel pour désigner « la campagne, par opposition à la ville », à l'instar de la célèbre fable de La Fontaine Le Rat de ville et le Rat des champs. Littré ne dit pas autre chose : « Au pluriel. La campagne en général », mais c'est avec la même inconséquence que celle dont fait preuve l'Académie qu'il mentionne la forme en plein champ dans le paragraphe pourtant consacré aux emplois de champ au pluriel. Le dictionnaire à la Semeuse, avec son bon sens paysan, préfère prudemment laisser le champ libre aux deux graphies : « En plein(s) champ(s), en rase campagne, loin des chemins. » Même neutralité du côté du Robert illustré : « En plein(s) champ(s), au milieu de la campagne. » Seul le Grand Robert, à ma connaissance, propose de couper la tomate, pardon la poire en deux : « Locution. En pleins champs : au milieu des cultures. Marcher, passer la nuit en pleins champs. [...] Locution. Au singulier. En plein champ. Technique. Culture en plein champ (opposé à hors-sol) [3]. » Autrement dit, le pluriel serait réservé au sens général et indéterminé de « au milieu des cultures », et le singulier, au sens technique (« agricole ») qui nous occupe ici. Quand elle serait peu respectée par les auteurs, à en croire les exemples cités plus haut, cette répartition sémantique a au moins le mérite d'accréditer l'idée que la graphie de plein champ est seule recevable. (Tomate) Cerise sur le gâteau, on y fait l'économie de deux s. La langue sait se montrer bonne pâte à l'occasion...
(1) Et aussi : « L'exécution des tirs en plein champ » (Joffre), « [...] aux fragments de chapiteaux égarés en plein champ » (Frédéric Vitoux), « Ils plantent la tente en plein champ, près de la mer » (Franz-Olivier Giesbert), mais « Millet, Rousseau vont bien chercher leurs motifs en pleins champs » (Élie Faure), « Il fallait aller la prendre [la marchandise de contrebande], l'avancer lentement, par étapes, la recacher en pleins champs » (Maxence Van der Meersch), « Dans ce pré-là, la bête a pris l'air en pleins champs » (Louis Étienne).(2) La définition de en plein champ a quelque peu varié au gré des éditions et des entrées : (à l'entrée « champ ») « loin de toute habitation » (1798), « au milieu des champs, de la campagne » (1835-1935) ; (à l'entrée « plein ») « au milieu d'un champ » (1762-1798), « au milieu des champs » (1835-1935).
(3) J'aurais plutôt pensé, pour ma part, que hors-sol s'opposait à en pleine terre, et sous serre, à en plein champ. Mais bon, je dois être dans les choux, sur ce coup-là, puisque l'Académie écrit à l'article « plein » de la neuvième édition de son Dictionnaire : « Plantation en pleine terre, de pleine terre, plantation faite directement dans la terre et non en pot ; s'applique aussi aux végétaux qui poussent à l'air libre et non en serre. »
Remarque : Panzani persiste et signe : « Des tomates mûres de plein champs », lit-on dans sa dernière publicité en date (2017). Des tomates mûries en plein champ aurait été de meilleure langue.
Ce qu'il conviendrait de dire
Des tomates de plein champ. votre commentaire
votre commentaire
-

« Mais cette spécialiste du droit parlementaire et de la procédure législative n’en n’a cure. »
(paru sur valeursactuelles.com, le 20 septembre 2017)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Bel exemple, s'il en est, de corruption de l'écrit par l'oral. Car, cela ne vous aura pas échappé, la répétition fautive de ne résulte ici d'une confusion phonétique. La coquille est d'autant plus cocasse que l'on sait à quel point l'usager n'a cure, d'ordinaire, de ladite particule négative, passée plus souvent qu'à son tour par pertes et profits si l'on en juge par la quantité de il a pas, il est pas qui fleurissent sur la Toile. Toujours est-il qu'abondance de biens nuit quelquefois...Mais commençons par rappeler ici que le substantif féminin cure, avant de prendre le sens usuel et médical de « traitement d'une maladie par une méthode, un médicament » (une cure d'amaigrissement, de repos, de sommeil), a d'abord signifié « soin, attention ; souci, préoccupation » : « Il receust la cure et le gouvernement de tout l'empire » (Les Grandes Chroniques de France), « Autrement la mordante cure, / Qui nous cuit l’âme à petit feu » (Ronsard), « Il ne considérait pas son exil comme le dispensant de la cure des âme » (Sainte-Beuve). Cette acception n'a plus cours de nos jours que dans l'expression n'avoir cure de, attestée depuis le XIe siècle au sens de « ne pas se soucier, ne pas tenir compte, n'avoir que faire de » : « De cela elle n'a cure » (Chateaubriand), « Il n'a cure et peu lui chaut du souper non plus que du gîte » (Verlaine), « On m'entretient de querelles, de doctrines dont je n'ai cure » (Paul Valéry).
En cas de pronominalisation du complément, il convient de ne pas se laisser abuser par la liaison entre le pronom en et la forme verbale à initiale vocalique. Aussi écrira-t-on : je n'ai cure de cela → je n'en ai cure, conformément aux principes élémentaires de notre syntaxe − je n'en veux pour preuve que ces exemples puisés aux meilleures sources (thermales) : « L'âne [...] se plaint en son patois ; le meunier n'en a cure » (La Fontaine), « Quant à la valeur même de mes écrits, je vous dis qu'ils n'en ont cure » (Gide), « On a beau lui prodiguer des avertissements, il n'en a cure » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie). Las ! force est de constater qu'en ce domaine nombreux sont les journalistes qui gagneraient à se voir prescrire une cure de rappel. Qu'on en juge : « Le chancelier n'en n'a cure » (Le Monde), « L'intéressé n'en n'a cure » (Le Point), « Une partie des nouveaux "Corbynistes" n'en n'a cure » (L'Express), « Mais les colons [...] n'en n'ont cure » (Libération), « Emmanuel Macron n'en n'a cure » (Le Huffington Post), « Les tourtereaux n’en n’ont cure » (L'Est républicain), « De ces considérations, [ils] semblent n'en n'avoir cure » (Le Progrès).
Quand on vous dit que le métier de correcteur n'est pas une sinécure !
Remarque 1 : N'avoir cure de fait partie de ces expressions toutes faites (avec n'avoir que faire de, n'avoir garde de, qu'à cela ne tienne, n'empêche, etc.) où ne est employé seul, c'est-à-dire sans auxiliaire de négation (pas, plus, point, jamais...). Ledit ne a beau y être tenu pour « indispensable [en français moderne] » par certains spécialistes (dont Hervé Curat), la locution est également attestée, quoique plus rarement, à la forme affirmative : « Le goût du Beau, dans la seule partie du public dont le poète puisse avoir cure, s'est anobli » (Verlaine), « Je me souviens de ses cuisses, quand le peignoir s'entrouvrait sans qu'elle en ait cure » (Simenon).Remarque 2 : La variante n'en avoir cure de est attestée de longue date : « Car li chaitif fil d'Adam n'en ont cure de vériteit » (Bernard de Clairvaux, XIIe siècle). Ce type de construction, où le complément est repris par le pronom en par effet d'insistance (Hanse) ou par simple redondance (Grevisse), est courant dans la langue familière moderne : en avoir marre de, en avoir par-dessus la tête de... On notera toutefois que, si en avoir assez de est désormais passé dans le registre usuel − comparez : « Avoir assez d'une chose, en avoir suffisamment, et, quelquefois, en être fatigué, rassasié » (Littré, 1872) et « J'en ai assez de ces bavardages ! » (Académie, 1992) −, c'est la forme « simple » n'avoir cure de qui continue de figurer dans les ouvrages de référence.
Remarque 3 : Cure désigne aussi la fonction ecclésiastique à laquelle est attachée la direction spirituelle d'une paroisse et, par métonymie, la demeure du... curé.

Ce qu'il conviendrait de dire
Elle n'en a cure. votre commentaire
votre commentaire
-

« C’était l’une des grandes craintes des services de renseignement : des djihadistes qui, fort de leur savoir-faire acquis sur les champs de bataille, reviendraient sur le sol européen pour y perpétrer des attentats. »
(Vincent Monnier, sur nouvelobs.com, le 8 octobre 2017)
« Des policiers se sont faits forts de maintenir une pression élevée. »
(paru sur lepoint.fr, le 31 juillet 2017)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Une fois n'est pas coutume, les spécialistes de la langue sont unanimes : l'adjectif fort varie régulièrement dans la locution être fort de quelque chose, qui signifie « tirer sa force, sa confiance, son assurance de quelque chose ». Témoin ces exemples puisés aux meilleures sources : « Fier de mes cheveux blancs et fort de ma faiblesse » (Corneille), « Les rois de France, forts de leur puissance » (Montesquieu), « Elle est forte de son bon droit, de sa longue expérience » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie), « Elle est forte de son expérience » (Dictionnaire du français de Josette Rey-Debove), « Forte de notre approbation, elle ne s'est pas laissé faire » (Hanse), « Une armée forte de cent mille hommes » (Larousse), « [Une ville] forte de 38 207 habitants » (Jean-Pierre Colignon), « [L'Académie,] forte de son autorité sur la langue et de la réflexion qu'elle a conduite » (Bernard Cerquiglini), « Les jeux sont déjà faits, entre ces quelques-uns, forts de leurs Partisans, et les autres, qui peinent à rassembler » (Alain Rey).Les choses se compliquent fortement avec l'expression se faire fort de, dans laquelle le traitement de fort n'en finit pas de diviser les grammairiens. Selon Thomas, « autrefois, l'adjectif fort ne variait pas au féminin et s'écrivait fors pour les deux genres, suivant en cela la règle de grand dans grand mère, grand route, etc. [...]. La question de dire se faire fort de ou se faire forte de ne se posait donc pas ». Mais de quel autrefois parle-t-on ? Car enfin, c'est oublier un peu vite, me semble-t-il, que, si les formes du latin fortis étaient effectivement communes au masculin et au féminin (on parle d'adjectif épicène) (1), celles de fort ne l'étaient à l'origine qu'au cas régime ; au cas sujet, lit-on dans les ouvrages qui s'intéressent à la déclinaison des adjectifs en ancien français, le masculin faisait forz (fors ou forts) au singulier et fort au pluriel, quand le féminin faisait fort au singulier et forz (fors ou forts) au pluriel. On écrivait donc : « reys est forz [le roi est fort] » (Albéric de Pisançon, XIe siècle), mais « fort aventure » (La Vie de saint Alexis, XIe siècle), « une fort fievre » (Chroniques de Saint-Denis). Ce n'est qu'au XIIe siècle, à en croire Hatzfeld et Darmesteter (Traité de la formation de la langue française, 1890-1900), que le sujet singulier devint forz au féminin, ce qui fit écrire à Littré que « l'ancienne langue disait uns hom fors, une femme fors ». Et avec la progressive disparition des cas sujets, au XIVe siècle, l'identité formelle des deux genres tendit à être rétablie, conformément à l'étymologie : fort au singulier et forz (fors ou forts) au pluriel. Mais pour combien de temps ? Il n'est que de consulter les dictionnaires historiques pour se faire une idée approximative : « Je me faiz forte sur ma vie que vous le trouverez ainsi » (Jean d'Arras, Roman de Mélusine, vers 1393), « Nous nous faisons fortes pour luy » (Antoine de La Sale, Le Petit Jehan de Saintré, 1456), « Ainsi est-il, je m'en fais forte / De ce drap » (La Farce de Maître Pathelin, vers 1456-1460), « [Elle] se fist forte de ses gens et subjectz » (Mémoires d'Olivier de La Marche, vers 1470), « Je me suis faicte forte que luy en envoiriés bientost une aultre [peinture] mieulx faicte » (Lettres de Marie Stuart, XVIe siècle), « Je me fais forte que, puis le temps Abel, Bergiers ne firent réveil si honnorable » (Le Banquet du Boys, vers 1525), « Je me feroys forte que le roy seroit obey » (Lettres de Marguerite de Navarre, 1534), « Je me fais forte que le combat des deux ne sera plustost failly, que je ne vous mette en barbe un mien frère » (Amadis de Gaule, 1541), « Je me fay forte de vous rendre ce Roy desloyal ou vif ou mort » (Histoire pitoyable du prince Erastus, 1565), « Se faisant forte d'aller avec Alphons son beau-frere » (François de Belleforest, 1579), « Sa femme, se faisant forte du consistoire, se mit à faire la meschante » (François Béroalde de Verville, Le Moyen de parvenir, 1617), à côté de « Il venoit une pucelle vers le roy, laquelle se faisoit fort de lever le siege de ladicte ville d'Orleans » (Chronique de la Pucelle, XVe siècle), « Je [une femme] me fay fort de vous y conduire » (Odet de Turnèbe, Les Contens, vers 1580). Vous l'aurez deviné sans effort : la graphie forte, attestée dès le XIIe siècle (2), s'est répandue du XVe au XVIe siècle au détriment de l'ancien féminin fort, de moins en moins compris à mesure que se généralisait le e analogique pour les adjectifs qui en étaient primitivement dépourvus (3).
Mais voilà, il a fallu que Vaugelas s'en mêlât ! « [Cet adjectif a] un usage assez étrange, mais qui est bien Français. C'est qu'une femme parlant dira tout de mesme qu'un homme, je me fais fort de cela, et non pas, je me fais forte [...]. Il est du nombre pluriel, comme du genre féminin ; car il faut dire aussi, ils se font fort de cela, et non pas, ils se font forts [...]. En ces phrases, [fort] est indéclinable et mis comme adverbialement », lit-on dans ses fameuses Remarques sur la langue française (1647). L'argument est nouveau, puisqu'il repose moins sur l'histoire que sur la nature de fort, lequel serait ici employé comme adverbe ; il est surtout déroutant, car enfin, si hésitation il avait pu y avoir jusque-là, c'était semble-t-il sur la variation de fort en genre, pas sur sa variation en nombre, acquise depuis l'origine. Qu'on en juge : « Les chevaliers d'Angleterre [...] se firent forts de toutes ces ordonnances » (Jean Froissart, XIVe siècle), « [Ils] se faisoient forts de ceulx de Rhodes » (Jean II Le Meingre, XIVe siècle), « Et ce sont faits forts iceux Messire Jean de faire jurer à l'Amiral [...] toutes les choses dessus écrittes » (Traité entre Charles V et Jean Ier de Castille, 1379), « Les gens de quoy ilz s'estoient faictz fortz n'y estoyent joinctz » (Philippe de Commynes, vers 1470), « Aucuns de eulz s'estoient fait fors et avoient promis au roy de ravir son filz » (Georges Chastelain, vers 1470), « Et combien que ceux de Sens, qui furent à Compiegne, se firent forts que ceux de Sens le consentiroient » (Chronique dite de Jouvenel des Ursins, XVe siècle), « Ceulx qui en sont venu parler s'estoient faicts fortz de plus qu'ilz ne povoient » (Jean du Bellay, 1535), « Ilz se font forts des pyonniers qu'ilz ont » (Charles de Marillac, 1541), « Ils s'essayeroyent et se faisoyent forts luy donner entree par le Chasteau » (Jean de Léry, 1574), « Ceux qui se font forts de vous attaquer promptement » (Les Œuvres de Guillaume du Buys, 1583), « Ceux qui se font forts de trop de choses ne viennent à bout d'aucune » (Pierre-Claude-Victor Boiste, 1635), « Se faisans forts que l'expres commandement de sa Majesté leur serviroit de descharge » (Henri II de Rohan, 1644). Se peut-il que cet « usage assez étrange » observé par Vaugelas soit né en ce début de XVIIe siècle, encore si friand des choses de l'Antiquité ? Rares sont pourtant les exemples d'invariabilité en nombre dans les textes de cette époque. J'en ai bien trouvé un, sous la plume d'Agrippa d'Aubigné : « Ils se font fort d'une telle amitié avec Villiers » (Histoire universelle, édition de 1616)... mais il fut prestement rectifié en Ils se font forts dans l'édition de 1626 ! Et cet autre en 1668 : « Ils se font fort de l'obeyssance des soldats », dans un traduction de Quinte-Curce... de la main de Vaugelas lui-même ! L'hypothèse d'une « mode » à la cour de Louis XIII puis de Louis XIV n'est pourtant pas à écarter d'un revers de manche. J'en veux pour preuve ce témoignage de Marguerite Buffet dans ses Nouvelles observations sur la langue française rédigées en 1668 (en réaction à celles de Vaugelas ?) : « Voicy un rencontre où une femme parlera de mesme qu'un homme ; elle dira, je me fais fort de cela, qui n'est bon que pour le masculin, il faut dire, je me fais forte de cela. » Mais, au risque de me répéter, il n'est question là encore que du traitement de fort au féminin, pas au pluriel. Résumons : de l'hésitation de l'usage quant à la variation de fort en genre, Vaugelas choisit de retenir l'invariabilité et réussit ce tour de force de l'étendre au nombre − de façon abusive, pour les uns, attendu que fort a toujours varié en nombre dans l'ancienne langue (comme en latin, du reste) ; de façon fort logique, pour d'autres, étant donné qu'« autrefois l's était caractéristique du nominatif singulier et disparaissait au nominatif pluriel : Ils se faisaient fort est un vestige de cette ancienne règle [que l'on ne comprenait déjà plus au XVe siècle] » (François Guessard, Examen critique de l'ouvrage de M. Génin, intitulé Des Variations du langage français depuis le XIIe siècle, 1846) (4). Les mauvaises langues, quant à elles, se persuaderont que Vaugelas avait déclaré que fort était adverbe... parce qu'il ne s’expliquait pas l’invariabilité apparente de l’adjectif !
Toujours est-il que l'auteur des Remarques, membre influent de la toute nouvelle Académie française, se fit fort de consigner l'invariabilité de fort après se faire dans la première édition (1694) du Dictionnaire de l'illustre Compagnie : « On dit, Se faire fort, pour dire, Se rendre caution, se rendre garant. Et en cette phrase, le mot de Fort s'employe tousjours indeclinablement. Une femme qui se fait fort de faire signer son mari. ils se faisoient fort d'une chose qui ne dépendoit pas d'eux. » L'invariabilité aura beau être maintenue dans les éditions subséquentes, elle ne fera toujours pas l'unanimité. Témoin ces exemples d'accord en genre et en nombre qui sont autant d'affronts à la prescription de Vaugelas : « Si vous la désirez, je me fais forte d’elle » (Alizon, 1637), « Les Allemans [...] se faisoient forts de l'emporter du premier assaut » (Abraham de Wicquefort, 1656), « A ceux qui se font forts de pouvoir tout comprendre » (Philippe Le Noir, 1658), « Ceux qui se font forts de nous faire reconnoistre un Pape en l'Eglise de Jesus Christ » (Jean Daillé, 1660), « Ceux qui se font forts de leur montrer que [...] » (Antoine Arnauld, 1672), « Cette ambitieuse Princesse se fit forte de son crédit » (Mme de Villedieu, 1673), « Ils se font forts de la [= la peste] faire cesser » (Pichatty de Croissainte, 1720), « La femme de l'empereur d'autre part se fait forte que le roi d'Arragon consentira que [...] » (Charles Pinot Duclos, 1745), « [Ils] se firent forts devant tous que [...] » (Saint-Simon, avant 1755), « Je me fais forte de vous faire trouver six heures de lucidité parfaite par jour » (Mme Carraud, Lettre à Balzac du 8 avril 1833), « Je me fais forte de la [cette place] lui faire obtenir » (Eugène Sue, 1843), « Elle se fait forte d'une justice expéditive et sommaire » (Alexandre Vinet, 1848), « Elle se faisait forte de subvenir à ses besoins » (John Bedot, 1860), « Elle se fit forte de le convaincre » (Ernest Serret, 1861), « [L’Église] se fit forte de dompter les passions du peuple » (Edmond About, 1864), « Ils se firent forts de sauver l'honneur du roi » (Jules Michelet, 1868).
En 1863, Littré jeta un pavé dans la mare en dénonçant le passage en force des académiciens : « Aujourd'hui que fort fait au féminin forte, il ne reste plus [dans elle se fait fort de] qu'un archaïsme qui mériterait sans doute d'être conservé s'il s'était transmis sans variation ; mais depuis longtemps, comme on peut voir [dans les exemples cités précédemment], l'analogie nouvelle de la langue l'a enfreint. Voilà pour le féminin ; quant au pluriel, dire : Ils se font fort et non forts, cela n'est fondé ni sur l'archaïsme ni sur la grammaire ; fort est ici adjectif et non adverbe. » À dire vrai, là est le nœud du problème : fort, dans se faire fort de, fait-il office d'adverbe, comme le prétend Vaugelas, ou d'adjectif, comme l'affirme Littré ? Nouvelle querelle de spécialistes. Pour le grammairien Scipion Dupleix, la cause est entendue : « C'est ici une pointillerie ou caprice à gêner les esprits, de vouloir faire passer ce [mot] fort pour adverbe », répond-il vertement à Vaugelas dans son livre La Liberté de la langue française dans sa pureté (1651). Et il ajoute : Fort, dans cet emploi, est « adjectif et déclinable en tous les genres et en tous les nombres ; de sorte qu'il faut [dire] : nous nous faisons forts ou fortes de cela, qui est autant à dire que nous nous sentons assez puissants ou puissantes, nous nous tenons pour assez puissants ou puissantes pour faire ou pour exécuter cela ». Littré ne dit pas autre chose : selon lui, la locution signifie littéralement « se donner pour assez fort, se dire assez fort pour » (d'où « se porter caution, s'engager à faire quelque chose »), ce qui suffit à prouver la nature adjectivale de fort. Pour Robert Alcide de Bonnecase Saint-Maurice, en revanche, la nature adverbiale de fort ne fait ici aucun doute : « Remarquez enfin ces façons de parler adverbiales : Elle se fait fort de faire cela [...] » (Remarques sur les principales difficultés de la langue française, 1672). Les Le Bidois père et fils, venus prêter main-forte à Vaugelas, acquiescent en chœur : se faire fort de « ne signifie pas "se rendre fort ou forte", mais "se piquer de" [comprenez : "se targuer, se vanter, se dire capable de"] ; le peu que fort garde, dans ce tour, de son sens ou de sa valeur ordinaire est cause qu'on le laisse sans accord » (Syntaxe du français moderne, 1967) − une façon comme une autre de laisser entendre qu'on a affaire à une locution verbale figée, un tout sémantique dans lequel fort n'est plus analysable isolément, n'a plus de fonction distincte. Entre les deux graphies, le cœur de Louis-Nicolas Bescherelle balance : dans sa Grammaire nationale (1837), il prône l'invariabilité sous le prétexte − capillotracté − que se faire fort de serait l'ellipse de se faire (un) fort (engagement) de (5), mais n'hésite pas à recommander l'accord dans son Dictionnaire national (1845) : « N'est-il pas en effet ridicule d'entendre dire à une femme, je me suis fait fort de réussir dans cette entreprise ? » Et dire que la grammaire est censée être son fort ! Plus subtile est la position de Jean-Paul Colin, Adolphe Thomas et Jean Girodet, pour qui tout dépend du sens de la locution : quand se faire fort de, suivi d'un infinitif, signifie « assurer qu'on a la capacité de », fort demeure invariable, mais quand se faire fort de, suivi d'un nom, est employé − plus rarement, convenons-en − au sens de « tirer sa force de », l'accord se fait avec le sujet car fort joue le rôle, non pas d'un adverbe, mais d'un adjectif. Comparez : Ils se font fort de battre leurs adversaires (= ils assurent avoir la capacité de, ils s'engagent à) et Ils se font forts de la faiblesse de leurs adversaires (= ils sont forts de, ils tirent leur force de) (6). Grevisse, pour sa part, ne fait pas la distinction et considère qu'« on ne peut qu'approuver les auteurs qui dans les expressions se faire fort de, se porter fort pour, font varier l'adjectif fort » (Le Bon Usage, édition de 1969).
Il faut dire qu'entre-temps un arrêté ministériel sur la simplification de la syntaxe française, en date du 26 février 1901, s'était opportunément penché sur notre affaire : « Dans la locution se faire fort de, on tolérera l'accord de l'adjectif. Ex. : se faire fort, forte, forts, fortes de » (7). L'Académie attendra encore plus d'un siècle pour faire amende honorable − fût-ce du bout des lèvres − dans la neuvième édition (2005) de son Dictionnaire : « Se faire fort de, s'estimer ou se dire capable de. Elle s'est fait fort, ils se sont fait fort d'obtenir leur consentement. On rencontre aussi : Elle s'est fait forte, ils se sont fait forts, mais fait reste toujours invariable » (à l'entrée « faire ») et « Se faire fort de, suivi d'un infinitif, s'estimer, s'affirmer capable de (dans cette locution, fort reste généralement invariable) » (à l'entrée « fort »). Rien d'étonnant, dès lors, que l'usage des auteurs modernes soit à ce point partagé : (accord) « La Libre Parole se fit forte de prouver que [...] » (Maurice Barrès, 1901), « Je me fais forte d'avoir encore de quoi resservir ces Messieurs » (Francis de Miomandre, 1908), « [Les gens qui] se font forts de n'ignorer rien des sentiments du prochain » (Henri de Régnier, 1913), « De bonnes autorités locales se font fortes de démontrer que ce buste n’est pas de Puget » (Louis Bertrand, 1923), « Je me fais forte d'avance de son acceptation » (Édouard Estaunié, 1927), « Ils se font forts de pouvoir [...] » (Roger Martin du Gard, 1936), « Catherine se faisait forte de convaincre peu à peu l'enfant » (Georges-Emmanuel Clancier, 1961), « Toute la jeunesse d'alors se faisait forte de remettre le bonheur à plus tard » (Bertrand Poirot-Delpech, 1974), « Vous vous faisiez forte de trouver un moyen » (Julien Green, 1977), « Sa visiteuse du matin avait dû bavarder et broder à l'envi, se faisant forte de conduire sur la bonne piste ceux qui la soutiendraient » (Gerald Messadié, 2009) ; (invariabilité) « Madame Lepoiroux s’est fait fort d’obtenir de vous madame, sinon engagement, du moins promesse verbale pour garantie d’un emprunt » (René Boylesve, 1905), « Elle se faisait fort de l'éclairer » (François Mauriac, 1927), « Ils se faisaient fort [...] de raser le Feu-Jouant avant l'été » (Maurice Genevoix, 1931), « Les manichéens se font fort de tout expliquer sans jamais faire appel à la foi » (Étienne Gilson, 1931), « Tant de gens se font fort de vous ouvrir toutes les portes » (Jules Romains, 1932), « Une voyante extra-lucide se faisait fort [...] de retrouver le lieu de sa cachette » (Henri Troyat, 1950), « Ils crurent à une vague révolte, qu'ils se faisaient fort de maîtriser » (Georges Bordonove, 1988), « Ils se faisaient fort de renégocier l'un les accords de Schengen, l'autre le pacte budgétaire » (François de Closets, 2013). Le plus fort, c'est que certains semblent avoir du mal à se déterminer. Ainsi de Romain Rolland : « Elle se faisait fort de les [les mauvaises herbes] arracher » (Jean-Christophe, 1907), mais « Sylvie se fit forte de le mettre d'aplomb avant trois mois » (L’Âme enchantée, 1924) et d'André Gide : « Les derniers venus qui prétendent m'aimer, se font forts de ne pas admirer Mallarmé » (Correspondance avec Valéry, 1898), mais « Dont elle se faisait fort de remporter l'assentiment » (Les Faux-Monnayeurs, 1925). Avouez que tout cela ne fait pas très sérieux...
Reste le cas tout aussi épineux du participe passé, quand notre locution est employée à un temps composé. Nous l'avons vu, l'Académie réclame l'invariabilité de fait dans elle s'est fait fort(e), ils se sont fait fort(s). Rien que de très logique quand fort y est employé adverbialement, puisque ce dernier forme alors locution avec le verbe, mais gageons qu'elle aura fort à faire pour justifier l'invariabilité du participe fait quand fort varie... L'Office québécois de la langue française, suivant la distinction de Girodet et consorts, préconise pour sa part de laisser le participe invariable quand l'expression est suivie d'un infinitif, mais de l'accorder régulièrement avec le complément d'objet direct qui précède (en l'occurrence le pronom personnel se, qui se rapporte au sujet) quand celle-ci est suivie d'un nom : Ils se sont fait fort de battre leurs adversaires (fait et fort restent invariables), mais Ils se sont faits forts de la faiblesse de leurs adversaires (ils ont fait qui ? se [étant forts], pronom COD mis pour ils et placé devant le participe ; fait et fort varient donc). Quant à Grevisse et à Goosse, s'ils avouent respectivement « approuver » et « ne pas pouvoir blâmer » (notez la nuance) les auteurs qui tiennent fort pour variable en genre et à plus forte raison en nombre, ils demeurent étonnamment silencieux sur la question de l'accord du participe. Vous, je ne sais pas, mais moi, je trouve que c'est un peu... fort de café !
(1) C'est également le cas de grand (du latin grandis), gentil (gentilis), mortel (mortalis), royal (regalis), vert (viridis), etc.
(2) « Une tor [tour] mout forte » (Roman de Thèbes), « Fu la guerre forte » (Roman de Rou), « Bataille avrum e forte e aduree [Nous aurons une bataille rude et acharnée] » (Chanson de Roland).
(3) Dans La Formation du féminin de l'adjectif et du participe passé (1937), Reginald Bowen croit pouvoir être plus précis : « À partir de 1450 forte s’établit comme la forme du féminin. »
(4) Reste à comprendre pourquoi cet éminent spécialiste parle de nominatif, alors que fort, sauf erreur de ma part, est ici attribut du pronom objet direct se, ce qui correspondrait plutôt à un accusatif (cf. le tour latin se fortem facere).
(5) « Se faire fort, dit Voltaire, signifie j'en réponds, je prends sur moi l'entreprise, je me flatte d'y réussir. Or, se flatter de la réussite d'une entreprise, c'est prendre l'engagement de la mener à bout malgré tous les obstacles qui pourraient s'y opposer. Cette explication justifie donc notre analyse. »
(6) Dans la seconde construction, l'adjectif fort est susceptible de degré (on peut dire : Ils se font plus forts encore de la faiblesse de leurs adversaires), ce qui n'est pas possible dans la première. On devine intuitivement que « fort, épithète ou attribut, ne semble pas pouvoir se construire avec de + infinitif » (Lars Otto Grundt, Études sur l'adjectif invarié en français, 1972). Pour autant, les partisans de l'accord ne manqueront pas d'objecter, à la suite de Littré, que se faire fort de suivi d'un infinitif signifie aussi bien « se dire assez fort pour »...
(7) Léon Clédat ajoute en commentaire : « L'accord de l'adjectif dans la locution se faire fort de est assurément logique. Si elle se fait forte nous choque un peu, c'est simplement parce que la locution n'est guère employée par les femmes, le sentiment qu'elle exprime étant peu féminin. » Autres temps, autres mœurs...
Remarque 1 : Les mêmes observations valent pour se porter fort pour quelqu'un (« se porter garant pour lui ou répondre de son consentement », d'emploi nettement moins fréquent) − à ce détail près, notent Hanse et Girodet, que le participe porté reste variable : Elles se sont portées fort pour nous. Allez comprendre...Remarque 2 : Le féminin étymologique persiste dans les noms propres Maisonfort, Pierrefort, Rochefort, Vïllefort, et dans le nom commun raifort, composé de l'ancien français raiz (« racine ») et de fort.
Remarque 3 : Il va sans dire que l'on n'hésitera pas à accorder l'adjectif fort après se faire dans des phrases comme : Sa voix se fit forte.

Ce qu'il conviendrait de dire
Des djihadistes qui, forts de leur savoir-faire acquis sur les champs de bataille, reviendraient sur le sol européen.Des policiers se sont fait fort(s) de maintenir une pression élevée (selon l'Académie).
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Richesse et difficultés de la langue française



