-

« Vous n'avez pas besoin de vêtements formels ou même d'avoir un chauffeur. »
(publicité pour la nouvelle Renault Mégane)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Entendu aujourd'hui à la télévision, ce message publicitaire doublement suspect au regard de la syntaxe. D'une part, ou (comme ni) ne peut coordonner que des éléments de même nature et de même fonction grammaticales (1) : « On peut dire : Un garçon intelligent ou travailleur (mais non Un garçon intelligent ou qui travaille beaucoup). On peut dire : J'enverrai une lettre ou je téléphonerai (mais non Pensez à la lettre ou à téléphoner) », confirme Girodet.D'autre part, l'emploi de la conjonction ou hors du sens affirmatif est incorrect, nous disent les spécialistes de la langue. Dans une proposition négative (ou de sens négatif), c'est en effet ni qui est censé jouer le rôle de coordonnant (2). Comparez : (phrase affirmative) Il devrait parler à son père ou à sa mère → (phrase négative) Il ne devrait pas parler à son père ni à sa mère. Vous pouvez l'approuver ou le blâmer → Vous ne pouvez ni l'approuver ni le blâmer.
Seulement voilà, force est de constater avec Grevisse que « ou s'introduit de plus en plus à la place de ni ». Le phénomène, attesté chez les meilleures plumes, n'est, du reste, pas récent : « Pas un seul petit morceau / De mouche ou de vermisseau » (La Fontaine), « Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon / D'être sans vous connaître ou savoir votre nom » (Molière), « Ce n'est pas que Chimene escoute leurs souspirs, / Ou d'un regard propice anime leurs desirs » (Racine), « Je n'ai pas daigné ôter mon chapeau à leur cercueil ou consacrer un mot à leur mémoire » (Chateaubriand), « Mais, ce n'était plus un grand homme ou un grand poète dont je visitais le séjour favori ici-bas » (Lamartine), « Je n'ouïs jamais parler d'une telle ou impatience ou irrésolution » (Balzac), « Personne n'a le pouvoir de les faire pleurer ou rire » (Mauriac), « Ni Dion, ni Spartien ne sont de grands historiens, ou de grands biographes » (Yourcenar).
Le recul de ni paraît à ce point généralisé en français contemporain que d'aucuns se demandent si l'intéressé n'est pas voué à disparaître, à l'instar de neïs (remplacé par même) et de néant (remplacé par rien) autrefois employés en corrélation avec ne dans la négation.
Le première classe Ornicar, où qu'il soit, attendra : c'est le soldat Nini qu'il faut sauver fissa !(1) Selon Hanse, « la langue classique hésitait moins que la nôtre à coordonner avec et (et aussi avec ou, ni, mais) des compléments qui n'étaient pas de même nature grammaticale (noms, adjectifs, pronoms, infinitifs, propositions complétives) : J'en suis persuadé et que de votre appui je serai secondé (Molière). Je le souhaite fort et de pouvoir remettre en train mon commerce de la poste (Sévigné). Le Roi craignait le poids des affaires et de manquer d'un homme capable de l'en soulager (La Rochefoucauld). Certaines de ces asymétries restent courantes ou possibles aujourd'hui ; on dit sans hésiter : C'est un élève intelligent, mais qui ne travaille pas (adjectif + relative). Il demanda son chemin et s'il était loin (nom ou pronom + interrogation indirecte). Etc. ».
(2) Autrement dit, ni ne peut s'employer en français moderne sans ne ou autre mot négatif (non, sans).
Remarque 1 : À l'inverse, ni s'est employé (aux XVIe et XVIIe siècles) avec le sens de « et » dans des phrases affirmatives représentant une négation atténuée : « Je serois bien fasché que ce fust à refaire, / Ny qu'elle m'envoyast assigner la premiere » (Racine), « Et voit-on, comme lui, les ours, ni les pantheres / S'effraier sottement de leurs propres chimeres ? » (Boileau) ou dans des propositions comparatives d'inégalité, où la négation est implicite : « Patience et longueur de tems / Font plus que force ni que rage » [c'est-à-dire : plus que ne font la force et la rage] (La Fontaine). Ce tour est aujourd'hui considéré comme archaïque.
Remarque 2 : Concernant la règle d'accord après deux sujets coordonnés par ou, voir le billet Ou.

Ce qu'il conviendrait de dire
Vous n'avez pas besoin de porter un costume ni même d'avoir un chauffeur (ou Vous n'avez pas besoin de costume ni même de chauffeur). 5 commentaires
5 commentaires
-

« J'aime mieux vous faire des câlins que le ménage » (propos d'un maître à ses chiens).
(publicité pour la marque Swiffer)
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Le sens du message n'aura échappé à personne : un bon maître préfère faire des câlins à ses chiens plutôt que de passer son temps à ramasser leurs poils. Il n'empêche, la phrase ainsi formulée contrevient aux règles de la syntaxe. En effet, pour pouvoir faire l'économie du second infinitif (dit corrélatif) dans une comparaison introduite par la locution aimer mieux, il faut qu'il soit identique au premier (cela va de soi !) et qu'il garde la même construction : J'aime mieux faire la vaisselle que faire le ménage peut ainsi être raccourci en J'aime mieux faire la vaisselle que le ménage. Selon le même principe qui veut que l'on ne répète pas d'ordinaire ce qui a déjà été exprimé, on pourra dire : J'aime mieux vous faire des câlins que (vous faire) des réprimandes, mais pas : J'aime mieux vous faire des câlins que (vous faire) le ménage. Vous l'aurez compris, dans notre affaire c'est le complément d'objet indirect vous qui coince, faute de pouvoir être mis en commun avec l'infinitif faire : si l'on fait des câlins à un chien, on ne saurait faire le ménage à un chien ! Il convient donc de tourner la phrase autrement : J'aime mieux vous faire des câlins que (de) faire le ménage (= j'aime vous faire des câlins mieux que je n'aime faire le ménage). Avouez que ça le fait nettement mieux, nom d'un chien !Remarque 1 : Quand aimer mieux s'emploierait régulièrement sans préposition (J'aime mieux jouer), les spécialistes de la langue distinguent d'ordinaire aimer mieux... que + infinitif, qui indiquerait une préférence de goût, de aimer mieux... que de + infinitif, qui exprimerait une préférence de volonté : J'aime mieux danser que chanter, mais J'aime mieux lui pardonner que de le réduire au désespoir. Selon Thomas, ces distinctions sont toutefois peu observées dans l'usage, et « aimer mieux... que de est plus courant qu'aimer mieux... que ». On peut aussi employer plutôt que (de), n'en déplaise à Féraud qui, à la fin du XVIIIe siècle, criait aussitôt au pléonasme.
Remarque 2 : Les mêmes observations valent pour il vaut mieux et préférer construits avec deux infinitifs.

Ce qu'il conviendrait de dire
J'aime mieux vous faire des câlins que (de) faire le ménage. votre commentaire
votre commentaire
-
Les adjectifs continu et continuel « désignent l'un et l'autre une tenue suivie », selon la formule continuellement reproduite de Nicolas Beauzée (1769), mais le premier est utilisé sur le plan spatial et temporel quand le second est désormais réservé à la seule valeur temporelle. Comparez : une pluie continue ou continuelle, un bruit continu ou continuel, mais une ligne continue, une étendue de sable continue.
N'allez pas croire pour autant que les deux mots, quand ils seraient employés à propos d'une durée, soient strictement synonymes : ce qui est continu ne peut être ni divisé ni interrompu depuis son commencement jusqu'à sa fin, nous dit-on, alors que ce qui est continuel ne dure que parce qu'il revient toujours par intervalles et peut donc impliquer l'idée d'interruption. Ainsi, précise Étienne Bonnot de Condillac dans ses Œuvres philosophiques (fin du XVIIIe siècle), « une pluie continue ne cesse point ; une pluie continuelle revient depuis longtemps ». Même son (continu) de cloche chez Littré : « Un bruit continu est un bruit qui ne présente aucune interruption ; un bruit continuel est un bruit qui se répète à chaque instant », qui ne s'interrompt que pour reprendre aussitôt, comme par exemple celui du cliquet d'un moulin en mouvement. De même, une fièvre non intermittente sera qualifiée de continue.
Force est toutefois de constater que ces distinctions ne sont pas toujours respectées par les auteurs : « Des névralgies [...] frappaient à coups continus la tempe » (Huysmans), « On entendait du bas des falaises monter les coups de bélier continus des vagues » (Gracq) ; « Les portiques, qui sont continuels à Padoue et servent d'une grande commodité pour se promener en tout temps et à couvert » (Montaigne), « Le train accepte tous les détours que lui proposent les méandres d'un petit cours d'eau, et ces courbes continuelles l'obligent à une extrême lenteur » (Gide), « les détours continuels de la route » (Gracq). Carrément passées sous silence par Grevisse, Thomas, Girodet et Hanse, elles tendent à être gommées dans les dictionnaires usuels, comme le montrent les définitions de continuel : « 1. Qui dure de façon continue [!] 2. Qui se répète presque sans interruption, qui revient constamment » (Grand Larousse), « Qui dure sans interruption, qui se renouvelle constamment » (Petit Larousse illustré), « Qui dure sans interruption ou se répète à des intervalles rapprochés » (Robert illustré). Le Nouveau Dictionnaire Larousse des synonymes n'en fait pas mystère : « [Ces subtilités relèvent] de l'usage soutenu, les deux termes étant concurremment employés l'un pour l'autre. » Vous voilà au courant (continu).
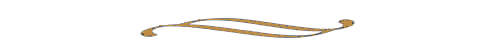
Remarque 1 : Ces adjectifs sont tous deux empruntés du latin continuus (« continu »), de continere (« tenir ensemble »). Curieusement, le Dictionnaire historique de langue française indique que « continu (vers 1306 ; après contenu, fin du XIIIe siècle) est à l'origine de continuel (vers 1160) » ! Serions-nous en présence d'une discontinuité temporelle ?Remarque 2 : Les mêmes observations valent pour les adverbes continûment (« d'une manière continue ») − ou continument, en orthographe rectifiée − et continuellement (« d'une manière continuelle ») : « J'ai écrit continûment de dix heures à quatre heures, c'est-à-dire sans interruption ; c'est un pays où il pleut continuellement, c'est-à-dire presque toujours » (La Grammaire selon l'Académie, 1842).
Remarque 3 : On notera avec Littré que, si le nom continuité correspond à l'adjectif continu, il n'existe pas en français de nom correspondant à continuel. « Comme continualité manque, continuité le remplace ; et ce substantif confond la distinction qui existe entre continu et continuel », observe le lexicographe. Rien n'empêche pourtant de parler du caractère continuel de tel fait.
Remarque 4 : Voir également le billet Continuer à / de.

 votre commentaire
votre commentaire
-

« Une recapitalisation de l'ordre de 10 millions d'euros est prévue en fin d'année pour satisfaire les obligations réglementaires » (à propos de la banque en ligne Morning).
(Gaël Cérez, sur latribune.fr, le 7 juin 2016 )
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Il n'est pas rare que l'usager de la langue s'interroge sur la construction du verbe satisfaire : celui-ci doit-il s'employer directement ou indirectement (c'est-à-dire avec une préposition) ?Aucune hésitation quand le complément est une personne, le tour satisfaire à quelqu'un − pour « lui accorder réparation » : « C'est maintenant à toi que je viens satisfaire » (Corneille) − étant sorti d'usage. On écrira donc satisfaire quelqu'un au sens de « le contenter (répondre à ses vœux, à ses désirs, fussent-ils amoureux) » ou, plus rarement, « lui payer ce qui lui est dû » : satisfaire un professeur, un client, un créancier, un amant. Quand le complément est une chose, satisfaire se construit directement au sens de « assouvir, combler », en parlant d’un besoin, d’un désir, d'une passion..., mais est suivi de la préposition à dès lors qu'il est question de se conformer à une règle morale, à une obligation, à une exigence (le sens est alors « s'acquitter de [ce qui est exigé], obéir, répondre », avec une personne comme sujet, ou « remplir [une exigence] », à propos d'une chose). Comparez : satisfaire une attente, un caprice, sa faim, sa conscience, le désir d'un partenaire amoureux, mais satisfaire à un ordre, à une loi, à ses devoirs, à ses engagements, à ses obligations militaires, à toutes les conditions requises, aux clauses d'un contrat, aux normes de sécurité, aux exigences du propriétaire, aux critères de sélection.
Seulement voilà, la règle − reprise en chœur par les ouvrages de référence − a beau paraître claire sur le papier, force est de constater avec Grevisse que les auteurs n'y satisfont guère : « Le complément de satisfaire, d'ordinaire construit directement, prend la préposition à quand il s'agit d'une obligation : satisfaire à ses devoirs, à ses engagements. [Cependant,] l'usage littéraire emploie à dans d'autres occasions », lit-on dans Le Bon Usage. Regardons-y de plus près : « satisfaire à leur avarice » (La Bruyère), « satisfaire à tous mes caprices » (Balzac, Sand), « Ils satisfaisaient à tous ses désirs » (Balzac), « ravi [...] de lui voir un désir et de pouvoir y satisfaire » (Hermant), « satisfaire aux inquiétudes et aux doutes de mes plus scrupuleux correspondants » (Gide), « sept jeunes gens et sept jeunes filles devaient être livrés pour satisfaire [...] aux appétits du Minotaure » (Id.), « pour satisfaire à ses vœux » (Françoise Giroud), « satisfaire aux alarmes de mes confrères » (Françoise Mallet-Joris), « satisfaire aux désirs de gloire et de puissance de sa mère » (Élisabeth Badinter). Si, dans ces exemples, la présence de la préposition paraît en effet contrevenir à ladite règle, son absence, dans d'autres, est parfois tout aussi suspecte : « Henri IV sembla satisfaire son goût, sa politique, et même son devoir, en accordant au parti calviniste le célèbre édit de Nantes » (Voltaire), « sans que l'Assemblée ait satisfait son engagement d'examiner la condition des Juifs » (Robert Badinter).
Grammairiens et lexicographes eux-mêmes n'auront pas peu contribué à entretenir la confusion. Jugez-en plutôt : « satisfaire à des commandes » (René Georgin), mais « satisfaire les commandes » (Académie) ; « satisfaire à ses besoins naturels » (Alain Rey), mais « satisfaire un besoin naturel » (Robert), « satisfaire leurs besoins naturels » (Académie) ; « satisfaire au désir de quelqu'un » (René Georgin), mais « satisfaire le désir de quelqu'un » (Robert), « satisfaire les désirs de tous » (Académie) ; « satisfaire l'attente de quelqu'un » (Littré, Robert, Larousse), mais « satisfaire, répondre à une attente » (Académie) ; « satisfaire une obligation » (Alain Rey), mais « satisfaire à ses obligations ou engagements » (Académie). Point n'est du reste besoin de s'adresser à la concurrence pour porter la contradiction ; l'Académie s'en charge très bien au sein de son propre Dictionnaire : « satisfaire une exigence » (à l'entrée « couverture »), mais « satisfaire aux exigences du corps » (à l'entrée « exigence ») ; « J'ai satisfait à sa demande » (à l'entrée « demande »), mais « Écouter les demandes, les vœux d'un solliciteur, les satisfaire » (à l'entrée « écouter ») et « satisfaire une grosse demande de mazout » (à l'entrée « demande »). Le TLFi paraît tout aussi en peine de distinguer entre « satisfaire un désir, agir de façon à combler le désir de quelqu'un » et « satisfaire à un désir, combler le désir de quelqu'un ».
Avançons une interprétation : satisfaire un désir, un besoin, une attente, une demande, c'est les assouvir, les combler et l'accent est mis sur le résultat, sur l'effet de satisfaction produit ; satisfaire à un désir, à un besoin, à une attente, à une demande, c'est répondre, obéir à une exigence réclamée par quelqu'un et l'attention est portée sur l'exécution, sur l'ampleur des moyens déployés pour donner satisfaction, conformément à l'étymologie satis (« suffisamment, autant qu'il faut ») et facere (« faire ») − satisfaire se construisant indirectement en latin. Avouez que la nuance est subtile... Tellement subtile que l'on est fondé à se demander avec Richelet s'il n'est pas des cas où les deux constructions, directe et indirecte, peuvent s'employer indifféremment : satisfaire sa curiosité ou à sa curiosité, satisfaire son ambition ou à son ambition, etc.
Vous l'aurez compris, le traitement de cette affaire par les spécialistes de la langue est loin d'être satisfaisant. Tout ce que l'on peut affirmer sans trop se tromper, c'est, d'une part, que l'on écrit satisfaire quelqu'un et, d'autre part, que satisfaire à quelque chose prévaut quand il s'agit nettement d'une obligation. Dans tous les autres cas, il semble possible d'employer l'une ou l'autre construction − et le plus souvent sans réelle distinction de sens −, même si celle avec préposition est moins fréquente dans l'usage courant.
Pas sûr que ces explications soient de nature à répondre à toutes les questions que vous vous posez sur ce sujet, mais il faudra, hélas ! vous en satisfaire.Remarque 1 : À la forme pronominale, le verbe satisfaire se construit avec la préposition de : se satisfaire de quelque chose.
Remarque 2 : Satisfaire se conjugue comme faire : vous satisfaites (et non vous satisfaisez).

Ce qu'il conviendrait de dire
Satisfaire aux obligations réglementaires. 1 commentaire
1 commentaire
-

« Le travail, seul échappatoire des Caennais » (à propos de l'équipe de football locale).
(paru sur ouest-france.fr, le 27 août 2016 )
 Ce que j'en pense
Ce que j'en pense
Il est des mots dont le destin, allez savoir pourquoi, est placé sous le signe de la confusion. Échappatoire fait partie de ceux-là.L'intéressé, nous dit-on, est du genre féminin : chercher, trouver une échappatoire, comprenez un moyen (excuse, expédient, faux-fuyant, prétexte, subterfuge) pour se tirer d'embarras ou, par extension, pour échapper à une réalité pénible. Force est pourtant de constater qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Ne lit-on pas dans le Dictionnaire du moyen français : « Eschappatoire, substantif masculin ou féminin » ? L'Académie, à ses débuts, n'était pas loin de partager cet avis : si le féminin est bien de rigueur à l'entrée « eschappatoire » de la première édition de son Dictionnaire (1694), c'est le genre opposé qui s'invite à l'entrée « porte » de la deuxième (1718) : « Un faux fuyant, une défaite, un eschappatoire. » Le mot est même exclusivement masculin chez Nicot (1606), chez Furetière (1690) et dans les dictionnaires de l'ancienne langue française de La Curne de Sainte-Palaye et de Godefroy.
À l'époque (comme encore trop souvent de nos jours), l'hésitation portait, du reste, aussi bien sur le genre que sur la graphie de notre substantif. Jugez-en plutôt : « Ce n'est rien qu'un eschapatore » (Le Mystère de la sainte hostie, 1444), « ung eschapatoire » (Jean Michel, 1486), « un eschapatoire » (Jean Calvin, 1545), « un autre eschapatoire » (François de La Noue, 1587), « un eschapatoire » (Louis Richeome, 1610), « par cet eschapatoire » (André Rivet, 1617), « un bel echappatoire » (Richelieu, 1647), « cet eschappatoire ne vaut rien » (Vaugelas, 1665), mais « ceste eschappatoire » (Martin du Bellay, 1569), « C'est une eschappatoire si sotte et inepte » (Guy de Brès, 1595), « Heureuse échappatoire ! » (Mathurin Régnier, 1606), « Ceste eschappatoire » (Jean Chapelain, 1662), « C'est une échapatoire » (Richelet, 1680), « Ils se préparent une échappatoire » (Bossuet, 1688). De son côté, Féraud préconisait la forme une échapatoire : « On écrit ordinairement ces mots avec deux p ; c'est l'ancien usage, qui n'est fondé sur rien » (Dictionnaire critique de la langue française, 1787). Il n'aura échappé à aucun esprit curieux d'étymologie que la réalité est tout inverse : les représentants de la famille d'échapper se sont d'abord écrits avec un p, avant d'être refaits à partir du XVIe siècle d'après le latin populaire excappare, issu de cappa (« sorte de capuchon, chape, manteau »), proprement « sortir de la chape en l'abandonnant aux mains de ses poursuivants » ou « quitter la chape ».
La confusion − qui ne date pas d'hier, donc − perdure aux siècles suivants : le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, qui donne échappatoire féminin à son entrée, ne laisse-t-il pas échapper « un pur échappatoire » dans l'article « Communes [Chambre des] » (et aussi « cet échappatoire » dans l'article « Deane », d'après Grevisse) ? Cent cinquante ans plus tard, le site Internet de l'Académie française n'est pas davantage épargné : « un échappatoire » s'est glissé dans la Réponse au discours de réception de Paul Morand par Jacques Chastenet. Confusion encore chez Dupré qui, après avoir soutenu à l'entrée « échappatoire » de son Encyclopédie du bon français qu'« il n'y a aucune raison de le faire masculin, sinon par lapsus de plume », en trouve finalement une (de raison) quelques pages plus loin, à l'entrée « écritoire » : « Quant au genre féminin dans écritoire, il était dû à la finale féminine malgré l'étymologie qu'impliquait le masculin représentant le neutre latin. Il en est de même pour échappatoire. » Oserai-je avouer ici que l'argument... m'échappe ? Car enfin, laisser entendre que la terminaison en -toire ait pu faire pencher la balance du côté du beau sexe, c'est oublier que les mots conservatoire, consistoire, exutoire, observatoire, réfectoire, suppositoire, territoire, etc. sont... du masculin. Quant au parallèle avec écritoire, il paraît particulièrement hasardeux, dans la mesure où ce dernier est emprunté du neutre latin scriptorium (« style en métal pour écrire sur la cire ») alors qu'échappatoire (milieu du XVe siècle) est directement dérivé d'échapper (fin du XIe siècle) si l'on en croit le Dictionnaire historique de la langue française, le Dictionnaire de l'Académie et le TLFi. Dupré fait-il allusion à l'ancêtre escapiamentum, neutre latin consigné par Pierre Carpentier dans son supplément au Du Cange ? La caution est mince et l'hypothèse, isolée...
Et l'on s'étonnera, après tout cela, que l'époque verse dans la confusion des genres. Allez, ne nous plaignons pas trop. Notre journaliste nous aura au moins épargné cette échapattoire de bien curieuse facture aperçue sous la plume de François Bégaudeau. Vrai, on l'a échappé belle !

Ce qu'il conviendrait de dire
Le travail, seule échappatoire pour les Caennais. votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Richesse et difficultés de la langue française



